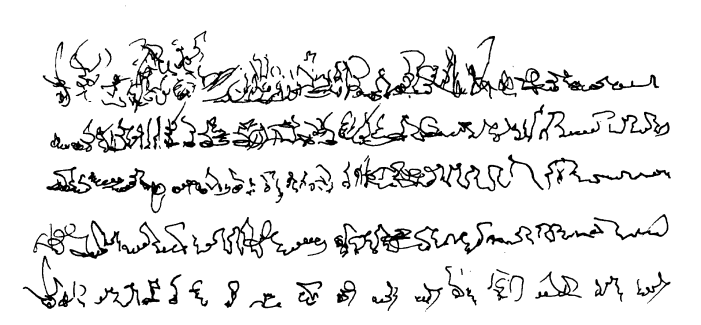Michaël FERRIER
Le japonisme
dans la littérature française
(1867-1967)


Sur le japonisme en littérature, les travaux demeurent dans un état de friche et même de pénurie assez étonnant, surtout quand on le rapporte à l’abondante production critique dans les arts visuels, et sur le japonisme en peinture en particulier.
Voici donc un immense mouvement artistique de dimension européenne, le plus important peut-être de la seconde moitié du XIXe siècle, mais qui n’aurait pas – ou très peu – touché la littérature...
Le texte ci-dessous démontre le contraire, en étudiant sur un siècle la diffusion du japonisme dans la littérature française pour en esquisser un début de problématisation et en montrer l’importance aujourd’hui largement sous-estimée.

Le grand Bouddha de Kamakura, photo T. Enami (Enami Nobokuni), ca 1898
Photo stéréoscopique colorisée et montée en Graphics Interchange Format
江南 信國 Source : Pink Tentacle
Le double paradoxe
d’un japonisme florissant en peinture mais anecdotique dans les Belles-Lettres, moderne en arts plastiques
mais périmé en littérature...
Nous sommes au XXIe siècle et, plus d’un siècle et demi après son éclosion, le japonisme fait toujours recette, comme le montrent les expositions ou les multiples ouvrages qui lui sont consacrés chaque année [1]. Dans cette activité de qualité inégale mais vibrionnante, deux constats retiennent l’attention : tout d’abord, la plupart de ces manifestations concernent les arts plastiques et, par extension, l’artisanat ou l’architecture. Sur le japonisme en littérature, les travaux demeurent au contraire dans un état de friche et même de pénurie assez étonnant, surtout quand on le rapporte à l’abondante production critique dans les domaines précités, et sur le japonisme en peinture en particulier. Voici donc un immense mouvement artistique de dimension européenne, le plus important peut-être de la seconde moitié du XIXe siècle, mais qui n’aurait pas – ou très peu – touché la littérature... Les dictionnaires entérinent dans leur grande majorité cette situation insolite : le japonisme y est défini comme « un terme d’histoire du goût recouvrant un intérêt pour l’art japonais et l’influence qu’il exerce sur l’art occidental » (Dictionnaire historique de la langue française, sous la dir. d’Alain Rey, éd. Robert), une « prédilection » pour l’art japonais (Dictionnaire de l’Académie), un « intérêt pour ce qui vient du Japon, en particulier pour l’art japonais » (Trésor de la Langue française, TLF), mais on s’aperçoit vite que les exemples visant à illustrer ces définitions sont presque toujours empruntés au domaine pictural (Whistler, Van Gogh et Monet pour l’Académie, « le japonisme des estampes et des laques » et Whistler pour le TLF).
Deuxième paradoxe : lorsque, par exception, il arrive qu’on évoque le japonisme en littérature, ce n’est le plus souvent que pour désigner des auteurs désuets ou démodés. Alors que le Japon est associé dans les arts plastiques – et, encore aujourd’hui, dans l’architecture, le mobilier, le textile, le design, la mode... – à une modernité qui semble inépuisable, le voici en littérature rangé au rayon obsolète, paré des senteurs surannées d’un exotisme de pacotille (Loti), aux implications idéologiques douteuses (Loti encore, officier de marine et épinglé comme tel par Edward Saïd dans son Orientalisme, ou Farrère, capitaine de corvette), lorsqu’il ne se réduit pas tout simplement à un appendice des arts décoratifs (les Goncourt). Le japonisme ne semble pas pouvoir trouver sa place dans la grande histoire littéraire, n’y entrant le plus souvent que par la bande ou par des auteurs méconnus (sinon méprisés), voire tombés dans un oubli plus ou moins complet (Judith Gauthier, Camille Mauclair, Kikou Yamata, Thomas Raucat...).
Je n’ignore pas l’intérêt critique renouvelé justifié que suscitent depuis quelques années certains de ces auteurs, Loti et les Goncourt notamment, mais il ne me semble pas remettre en cause ce constat. Si quelques rares ouvrages proposent des vues synthétiques, les monographies consacrées à l’importance du Japon dans l’œuvre d’un écrivain français font cruellement défaut. À ma connaissance, seul Luc Fraisse a eu l’intuition de montrer l’importance du japonisme dans l’œuvre d’un écrivain majeur, Marcel Proust, en le reliant explicitement à ses conceptions esthétiques et à sa technique littéraire [2]. C’est l’exception qui confirme la règle. Hors celle-ci, le japonisme en littérature semble n’exister pas ou, et cela est peut-être pire, n’exister en quelque sorte que par raccroc, en marge ou à la remorque d’un japonisme pictural, lié à des enjeux esthétiques dépassés [3].

Pavillons chinois et japonais, Exposition universelle, 1867
Source : Le Monde illustré, 1867
Ce double paradoxe d’un japonisme florissant en peinture mais anecdotique dans les Belles-Lettres, moderne en arts plastiques mais périmé en littérature, me semble poser toute une série de questions importantes sur la façon dont en France on considère la littérature mais aussi dont on la pratique, sur le rapport aux langues étrangères, sur les relations centre-périphérie ou la place spécifique qu’occupe la littérature dans notre pays. Je n’aurai pas le temps, dans l’espace qui m’est ici imparti, d’aborder en détail l’ensemble de ces questions mais je voudrais suivre sur un siècle la diffusion du japonisme dans la littérature française pour en esquisser un début de problématisation et en montrer l’importance aujourd’hui largement sous-estimée.
Notre parcours débutera en 1867, de manière quelque peu anachronique puisque le terme de « japonisme » ne fut lancé qu’en 1872 par Philippe Burty. Mais 1867 est une date importante : pour la première fois, le Japon participe activement à une Exposition universelle (à l’Exposition de Londres, en 1862, c’est l’ambassadeur d’Angleterre au Japon, Sir Rutherford Alcock, qui avait sélectionné les objets présentés) et, cette même année, les Goncourt publient Manette Salomon, où le peintre Coriolis se délecte d’un album d’estampes japonaises, « ces pages pareilles à des palettes d'ivoire chargées des couleurs de l'Orient, tachées et diaprées, étincelantes de pourpre, d'outremer, de vert émeraude ». Il s’achèvera, pour des raisons que je dirai, en 1967, et nous verrons alors comment le Japon aura pris une importance, et même une place stratégique dans la littérature française, qu’un siècle plus tôt rien ou presque ne laissait présager.

Exposition universelle de 1867, délégation japonaise
Source : Le Monde illustré, 1867
1. Le japonisme en littérature :
une annexe des arts décoratifs ?
Si le japonisme révolutionne la peinture,
il ne semble se réduire, en littérature,
qu’à l’évocation d’une ambiance,
d’une atmosphère,
menaçant à chaque instant de verser dans les pièges de l’exotisme, le regard condescendant ou les facilités de l’ornement.
Alfred Stevens,
La Parisienne japonaise, 1872

C’est donc un critique d’art, Philippe Burty, qui en 1872 introduit le terme « japonisme » (dans une série d’articles pour la revue Renaissance littéraire et artistique), et ce sont d’abord des peintres et des collectionneurs qui, pendant plusieurs années, vont porter le goût du Japon sur la scène française. De fait, le Japon est d’abord utilisé dans la littérature française comme un référent presque uniquement ornemental, un bibelot, un décor, pour ne pas dire une décoration. Dans Bel-Ami par exemple (1885), il surgit dans la description de la garçonnière de Duroy, qui l’agrémente « de menus bibelots japonais » pour séduire sa maîtresse, Mme de Marelle :
Il appliqua sur les vitres de la fenêtre des images transparentes représentant des bateaux sur des rivières, des vols d'oiseaux à travers des ciels rouges, des dames multicolores sur des balcons et des processions de petits bonshommes noirs dans les plaines remplies de neige. Son logis, grand tout juste pour y dormir et s'y asseoir, eut bientôt l'air de l'intérieur d'une lanterne de papier peint.
Deux ans plus tard, dans Pierre et Jean (1887), c’est un personnage de jeune veuf, Jean, qui désire impressionner sa fiancée et décore lui aussi sa salle à manger de « lanternes japonaises »...
« Oiseaux découpés », « feuilles coloriées », « collection de crépons, de petits éventails et de petits écrans » destinés à la séduction et explicitement reliés à une imagerie artistique mais aussi érotique : il ne faut pas voir dans cette utilisation du Japon un tic thématique propre à Maupassant mais, bien au contraire, l’expression des stéréotypes les plus souvent attachés au goût japonais dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dès que le Japon apparaît dans un texte, il est presque aussitôt connecté à l’adjectif « petit » et indexé à l’art pictural ainsi qu’à des allusions plus ou moins subtiles à l’art de l’amour (de la sensualité à la sexualité, de l’érotisme à la pornographie). Dans Madame Chrysanthème par exemple (Pierre Loti, 1893), le mot « petit » revient 357 fois en 56 chapitres ! La première vision du Japon, à partir du navire, consiste en une série de « petits sommets roses », où transparaît en filigrane l’art des estampes. Madame Chrysanthème est mentionnée sous l’appellation récurrente de « petite femme », les jardins japonais sont « des petits rochers, des petits lacs, des arbres nains », et même une énorme fête à Nagasaki se transforme en une « dînette » :
À terre, une quantité de petits réchauds, de petites pipes, de petits plateaux de laque, de petites théières, de petites tasses – tous les accessoires et tous les restes d’une orgie japonaise ressemblant à une dînette d’enfants.
Chez Proust lui-même, qui sait pourtant en faire une utilisation plus variée et plus profonde, le Japon sert à « tout ce qui peut situer socialement, parfois sexuellement, les personnages, pour leur raffinement ou pour leur vulgarité » : les peignoirs japonais d’Odette la connotent comme une cocotte, et Proust ne manque pas de rappeler par la bouche de Mme Verdurin, l’épisode de « la salade japonaise », une recette de cuisine empruntée à une pièce de théâtre de Dumas fils, où elle est assaisonnée de sous-entendus érotiques (« moules », « calotte »...)[4].
Les Goncourt enfin ne font pas exception, bien au contraire : Edmond consacre un livre à Utamaro, le peintre des maisons vertes (1891), qui allie dès son titre la peinture et l’érotisme (les maisons vertes sont le nom des bordels où le peintre meurt de « l’abus du plaisir »). Il fait aussi part dans le Journal, en des termes saisissants, de sa passion pour les estampes érotiques, qu’il fait admirer à Rodin :
admiration devant ces dévalements de têtes de femmes en bas, ces cassements de cou, ces extensions nerveuses des bras, des contractures des pieds, toute cette voluptueuse et frénétique réalité du coït, tous ces sculpturaux enlacements de corps fondus et emboîtés dans le spasme du plaisir.
Apollinaire se souviendra de cette veine bien vivace du japonisme dans la littérature française lorsqu’il écrira, quelques années plus tard, Les Onze mille verges (1907) : non seulement les trois personnages principaux s’y rencontrent dans un décor japonais – la jeune Culculine d'Ancône présente le prince Mony Vibescu à son amie Alexine Mangetout « dans un boudoir luxueux décoré d'estampes japonaises obscènes » – mais on y voit bientôt apparaître une mousmé répondant au nom délicat de Kyliému, et dont les poils de pubis évoquent irrésistiblement... un pinceau de calligraphie.

Représentation de la Japonaise Kyliému dans Les Onze Mille Verges : les amours d’un hospodar (1907), édité à Bruxelles (1942), dessin non signé
Érotisme, peinture, réduction... Si l’on voulait résumer cette première phase d’une formule un peu suggestive, on pourrait dire que nous sommes en présence d’un petit Japon, joli, sexy et bien roulé – « roulé » faisant ici référence, bien entendu, aux kakejiku ou aux emakimono, les fameux rouleaux peints. Si le japonisme révolutionne la peinture, mettant à la disposition des artistes des clefs novatrices et leur ouvrant des voies inédites au sein de la crise de la représentation (composition décentrée, vue plongeante, distorsions de la perspective, cadrages insolites, nouvelles techniques du choix et de l’application des couleurs...), il ne semble se réduire, en littérature, qu’à l’évocation d’une ambiance, d’une atmosphère, menaçant à chaque instant de verser dans les pièges de l’exotisme, le regard condescendant ou les facilités de l’ornement. Surtout, il se situe d’abord dans les registres du visuel, de l’optique, de la perspective. Ceci est parfaitement résumé dans la préface à Chérie des Goncourt (1884), où il est décrit « en train de révolutionner l’optique des peuples occidentaux », apportant « une coloration nouvelle, un système décoratoire nouveau, enfin si l’on veut une fantaisie poétique dans la création de l’objet d’art. » On le voit, le vocabulaire concerne avant tout les arts plastiques et il est tentant, dès lors, de voir le japonisme en littérature comme une simple annexe des arts décoratifs.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : tout d’abord, il est évident que l’impact extraordinaire des estampes et leur diffusion spectaculaire ont d’emblée placé le Japon presque uniquement dans le champ des références visuelles. D’autre part, les traductions de littérature japonaise sont partielles et tardives : la première anthologie digne de ce nom ne voit le jour qu’en 1910 [5], et les deux chefs-d’œuvre fondateurs que sont le Dit du Genji et les Notes de chevet doivent attendre 1928. Les écrivains sont donc en quelque sorte condamnés, s’ils ne font pas le voyage – et bien peu le font – à passer par le filtre des représentations plastiques. Enfin, il faut aussi se résoudre à évoquer une certaine arrogance française en matière de littérature, tant il est vrai que celle-ci occupe une place spécifique dans l’histoire de notre pays. À cet égard, il est intéressant de comparer les textes écrits à partir duJapon à la même époque par le Britannique Rudyard Kipling (qui y voyage en 1889 et en 1892) [6], ou par l’Irlandais Lafcadio Hearn (qui s’y installe en 1890 et adoptera même la nationalité japonaise sous le nom de Koizumi Yakumo 小泉八雲 [7]), pour prendre la mesure d’une certaine myopie hexagonale et des difficultés d’un véritable décentrement, problématique qui n’a d’ailleurs peut-être pas tout à fait disparu aujourd’hui.
2. Un renouveau poétique
et une révolution du regard
Une certaine mise en tension
de la représentation du monde
s’opère par le biais du référent « Japon », r�évélatrice de certaines impasses
mais aussi annonciatrice de solutions promises à un bel avenir.

La danseuse Sadayakko, Picasso, 1901

La danseuse Sadayakko
Source : Raras Artes

La danseuse Sadayakko, Picasso, 1901
Cependant, si l’on veut ne pas s’en tenir à cette première impression, on peut aussi souligner les mutations que le goût japonais commence à apporter dans la littérature française. On peut, pour simplifier, en esquisser les contours dans trois grandes directions : tout d’abord, étant donné son positionnement quasi-exclusif dans le registre optique, il n’est pas étonnant de constater que le japonisme va générer une influence tout à fait considérable sur les arts de la scène. Depuis le début du siècle, les spectacles de Madame Sadayakko (Kawakami Sadayakko 川上貞奴, née Koyama Sada) ou de la danseuse Hanako (Ôta Hisa, 大田 ひさ) ouvrent de multiples horizons à la dramaturgie (gestuelle, vêtements, couleurs, musique, jeux de la voix et des intonations, rapports entre la scène et la salle...). Il manque encore en France une étude de grande ampleur sur cette influence, mais il est évident que la révolution du langage théâtral est pour une large part redevable au théâtre japonais : tout autant qu’au music-hall, Artaud, Copeau, Dullin ou Claudel (dont il n’est pas anodin de rappeler que Le Soulier de satin a été en grande partie composé au Japon) doivent beaucoup au nô et au kabuki, dans des proportions et avec des transformations qu’il reste encore à examiner [8].

Masque de Hanako, type C

Hanako
Source : Zoé Balthus

Masque de Hanako, type C
.jpg)
Rodin, Hanako (1906-1907)
En ce qui concerne le roman, l’apport du japonisme est à la fois plus lent et plus complexe à évaluer : il me paraît toutefois probable – mais ici aussi, un immense chantier de recherches s’ouvre devant nous – que l’art japonais n’est pas étranger à un certain renouvellement du personnel romanesque, des thématiques traditionnelles, des modalités de l’écriture romanesque et, peut-être, de la conception même de l’acte d’écrire. En effet, alors même que le chef de file du naturalisme, Emile Zola, fut un collectionneur d’estampes et le grand défenseur du japonisant Manet, et que les frères Goncourt déclarent, dans la préface de Chérie, que « les trois grands mouvements artistiques et littéraires de la seconde moitié du XIXe siècle » ont été « la recherche du vrai en littérature, la résurrection de l'art du XVIIIe siècle, la victoire du japonisme », on s’interroge trop peu, me semble-t-il, sur les relations qu’ont pu entretenir ces trois domaines au sein de leurs œuvres romanesques, ou chez d’autres créateurs de la même époque.
Relations complexes et sans aucun doute contradictoires. Quel rapport par exemple, et quelle articulation, entre « la recherche du vrai en littérature » et la fameuse « fantaisie » de l’art japonais vantée par les Goncourt ? Plus concrètement, quelles inventions ont-elles été rendues à la fois nécessaires et possibles par le japonisme dans les techniques de la description littéraire, notamment dans l’évocation des couleurs ? Y a-t-il eu une influence – et si oui, de quel ordre et dans quelles limites – de l’archétype de la geisha sur les personnages de prostituées qui peuplent le roman français de la deuxième moitié du siècle ? L’arrivée du Japon dans le champ littéraire a sans nul doute généré bien des problèmes spécifiques de technique narrative, comme le montre ce passage de Madame Chrysanthème où Loti pointe l’étonnant embarras où l’entraîne la description de ce pays par rapport aux valeurs romanesques traditionnelles :
Il est vrai, tout un imbroglio de roman semble poindre à mon horizon monotone ; toute une intrigue paraît vouloir se nouer au milieu de ce petit monde de mousmés et de cigales : Chrysanthème amoureuse d'Yves ; Yves de Chrysanthème ; Oyouki, de moi ; moi, de personne.... Il y aurait même là matière à un gros drame fratricide, si nous étions dans un autre pays que celui-ci ; mais nous sommes au Japon et, vu l'influence de ce milieu qui atténue, rapetisse, drolatise, il n'en résultera rien du tout.

De gauche à droite : Yves, O-kiku san, Loti,
Nagasaki, 1885

Excelsior/ピエール・ロティ 藤田嗣治 挿画本「お菊さん」
Maman Chrysanthème, édition illustrée par Foujita

Les mêmes, sans chapeau !
Indubitablement, une certaine mise en tension de la représentation du monde s’opère par le biais du référent « Japon », révélatrice de certaines impasses mais aussi annonciatrice de solutions promises à un bel avenir. Il y a par exemple dans le leitmotiv du « petit », qui est une des constantes les plus caractéristiques des textes français sur le Japon, un changement d’échelle du récit, une esthétique du fragment et du discontinu qui commence à se mettre en place dès Loti (dans le même chapitre, il évoque les « détails saugrenus » et les « minutieuses notations de couleurs, de formes, de senteurs, de bruits » qu’il commence à privilégier dans sa prose), et trouvera chez certains auteurs comme le Roland Barthes de L’Empire des signes (1970) une forme à la fois bien plus sophistiquée et ouvertement revendiquée.
Enfin, le japonisme a sans nul doute accompagné, voire suscité dans un certain nombre de cas, une modification générale des valeurs et de la sensibilité. Son influence est importante dans la lutte contre le moralisme bourgeois empesé de l’époque, et l’on se souvient que les Goncourt le brandissaient comme un étendard dans leur combat contre l’académisme, en vantant la fantaisie de cet art qui déplaçait les lignes et leur donnait un éclat inhabituel : métaphore plastique dont il serait intéressant de chercher les équivalents dans leur pratique d’écriture. Il serait par exemple révélateur d’étudier le rôle que le japonisme a pu jouer dans la découverte de nouveaux sujets extraits de la vie quotidienne et des sensations ordinaires soudain retrouvées sous un jour neuf. On sait comment certains sujets de Hokusai (les femmes au bain par exemple, dans une attitude quotidienne, intime) ont eu un écho extraordinaire chez les peintres à la recherche d’une vérité des gestes, libérée de la solennité compassée de la peinture bourgeoise : mais il y a là un réservoir de traits qui a également touché la littérature, depuis la poésie – Paul-Louis Couchoud, l’introducteur du haïku en France, parlait du « besoin de la sensibilité contemporaine qui, depuis Verlaine et Mallarmé, cherche à fixer par la poésie les sensations et le sentiment élémentaires » – jusqu’aux recherches de Georges Perec, utilisant les Notes de chevet de Sei Shônagon pour tracer les linéaments d’une écriture moderne en prise avec ce qu’il nommait « l’infra-ordinaire » [9].
Le retour des premiers voyageurs qui ont séjourné au Japon, ainsi que les premières traductions des textes japonais vont peu à peu susciter une meilleure connaissance du Japon et un engouement mieux informé pour de nouvelles formes poétiques. De ce point de vue, le désastre de la Première Guerre mondiale a sans nul doute également joué un rôle important : la Crise de l’esprit diagnostiquée par Paul Valéry dès le lendemain de la guerre (1919, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles »...), et celle de la civilisation occidentale (Le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler est publié en Allemagne dès 1918), ouvrent la voie à ce que Malraux décrira en 1926 comme La Tentation de l’Occident : « un effort de renouvellement, cherché ailleurs que dans son propre fonds, par le recours aux cultures étrangères. » Dans ce « recours aux cultures étrangères », on connaît la place du Japon chez Malraux. On sait moins que Paul Valéry a préfacé le premier ouvrage de Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises (Editions Le Divan, 1924), un recueil de contes et de traductions de nô. Mais à cet égard, c’est l’extraordinaire fortune du haïku qui constitue le plus sûr repère d’une pénétration poétique s’affranchissant des stéréotypes et des joliesses dérivées du japonisme pictural pour ouvrir la littérature française à des formes inouïes.

Le plus fameux poème de Bashô
La généalogie de l’introduction du haïku en France a été faite à plusieurs reprises. Disons en résumé qu’elle doit beaucoup à un homme, Paul-Louis Couchoud, rentrant « imprégné, ébloui, parfumé » d’un séjour au Japon en 1904 et publiant dès l’année suivante avec deux amis, Albert Poncin et André Faure, un ouvrage contenant 72 « haïkaï » sous le titre Au fil de l’eau (1905) [10]. Mais l’on souligne trop peu que c’est vraiment après la Première Guerre mondiale que le phénomène prend de l’ampleur : quel que soit son caractère précurseur, Au fil de l’eau est une simple plaquette de quinze pages, tirée à 30 exemplaires et non commercialisée. Dans les années 1920 au contraire, c’est une explosion éditoriale. La Nouvelle Revue Française en publie à plusieurs reprises (82 « haï-kaïs » dans le numéro de septembre 1920, une autre livraison en avril 1924...), ainsi que de nombreuses autres revues : Le Pampre, Les Nouvelles littéraires de Benjamin Crémieux, Les Lettres de Fernand Gregh, La Grande Revue, La Gerbe [11]... Parmi les écrivains, Paul Claudel bien sûr, mais aussi Jules Romains, Jules Renard, Jean-Richard Bloch se prennent de passion pour le haïku, Jean Paulhan s’y intéresse presque autant qu’aux proverbes malgaches et les surréalistes s’en inspirent : Eluard publie une série de onze haïkus intitulée Pour vivre ici en 1920, et André Breton évoquera Bashô dans Signe ascendant en 1942.
Nous ne sommes plus ici seulement dans le registre de l’accessoire décoratif ni même du renouveau thématique, mais bel et bien dans une véritable pratique d’écriture qui emprunte ses procédés à des techniques japonaises. Certains poèmes d’Eluard vont jusqu’à suivre en français les exigences de la métrique japonaise, à savoir l’alternance 5-7-5 syllabes propre à l’art du haïku :
Femme sans chanteur,
Vêtements noirs, maisons grises,
L’amour sort le soir.
Le succès du haïku – puisque c’est sous ce nom qu’il nous est désormais connu – s’explique sans doute parce qu’il vient à point nommé pour délivrer la poésie française de certaines tendances didactiques et discursives déjà dénoncées par Rimbaud ou Verlaine en leur temps. Prenant à la fois ses distances avec le sentimental et le descriptif, cette forme poétique est aussi superbement appropriée à l’évocation d’une sensibilité que la guerre a rendue à la fois plus meurtrie et plus aiguisée. Comme l’écrit dès 1916 Julien Vocance, un poète injustement méconnu aujourd’hui, mais qui illustre à merveille ce renouveau :
Le poète japonais
Essuie son couteau :
Cette fois l’éloquence est morte.
Ou encore :
Chaud comme une caille
Qu’on tient dans le creux de la main,
Naissance du haï-kaï
Julien Vocance (de son vrai nom Joseph Seguin) mériterait d’être redécouvert par l’histoire littéraire. Ses « cent visions de guerre », haïkus composés dans la boue et sous la mitraille en 1916, n’ont pas pris une ride et peuvent se comparer aux poèmes d’Apollinaire sur la guerre : Vocance y utilise toutes les ressources du haïku pour décrire à la fois l’horreur du conflit et les rares moments de répit miraculeusement suspendus qui y subsistent, et l’on peut voir dans ses soldats égarés, « les émincés, les raccourcis, dans des vêtements gris », « la mort dans le cœur » et « l'épouvante dans les yeux », une saisissante évocation de la condition humaine [12].

Julien Vocance
(pseudonyme de Joseph Seguin)



Dessin de la couverture d'Au fil de l'eau, 1905
Paul-Louis Couchoud, 1942
(©Gamet, 2014)
Brièveté, absence de lyrisme, aspect fragmentaire et neutre : le haïku est appelé à un bel avenir dans la poésie moderne et contemporaine. Guillevic, Du Bouchet, Jacques Dupin, Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy... rares sont les poètes importants qui ne lui rendent pas un hommage appuyé en se le réappropriant chacun à sa manière. Mais l’exemple le plus connu de cette extraordinaire diffusion, qui ne touche pas seulement les écrivains professionnels, est une minuscule grenouille née sous la plume de Bashô et qui va connaître une propagation internationale...
Furu ike ya 古池や
kawazu tobikomu 蛙飛込む
mizu no oto 水の音
À partir ce ces quelques mots (ah un vieil étang, une grenouille saute, bruit de l’eau), les poètes du monde entier vont proposer les traductions les plus variées [13]. Dans les années 1970 notamment, les traductions s’intensifient. Les grenouilles changent et les étangs se diversifient. Le fameux étang est traduit au singulier ou au pluriel, quelquefois avec un article indéfini (« un vieil étang »), d’autres fois avec un défini (« le vieil étang »). La célèbre grenouille tantôt « s’élance » et tantôt « plonge », parfois « saute » et parfois « sombre »... Le «bruit de l’eau » est rendu par « des sons d’eau », une eau qui « se brise », et même « un ploc dans l’eau ! ». Certains essaient de rester au plus près du texte ; d’autres éprouvent au contraire le besoin de « poétiser » la traduction, de l’étoffer. Le sinologue René Etiemble change ce clapotis en une « rumeur » et la grenouille en une « raine » : « Une vieille mare – Une raine en vol plongeant et l'eau en rumeur »... Alors, chaque traduction relance le trajet de la belle grenouille, qui n’en finit pas de prendre son essor. En France, au Québec, au Sénégal, à chaque grenouille de Bashô qui bondit, la poésie resplendit.
3. Ouvertures contemporaines
Henri Michaux, Encre de Chine n° 2, 1959
©Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP ©Adagp, Paris

Au fur et à mesure que le turbulent batracien de Bashô fait couler beaucoup d’eau (et d’encre), et que ses ondes poétiques se propagent à travers le temps et l’espace, on voit bien à quel point l’utilisation du Japon s’est transformée, a gagné en vigueur et en variété. À cet égard, la date de 1967 me semble pouvoir être retenue comme une date-repère ou, pour mieux dire, une date-charnière. À cette date en effet, Henri Michaux publie la troisième version de son livre, Un Barbare en Asie. Paru en 1933, ce livre a d’abord été réédité en 1945 mais c’est lors de la nouvelle édition de 1967 que Michaux transforme considérablement la partie consacrée au Japon : alors que l’édition originale regorgeait de piques assassines contre l’Empire du Soleil levant, Michaux ajoute en 1967 une batterie de notes nouvelles qui traduisent toutes un changement de regard et, comme il l’écrira dans une quatrième et dernière réédition, en 1984 : « une étrange connivence qui augmente ».
Cible de tous les sarcasmes en 1933, où le pays était décrit comme un véritable enfer (« Le Japon a un climat humide et traître. L’endroit du monde où il y a le plus de tuberculeux. (…) Les femmes, l’air de servantes (toujours servir), les jeunes, de jolies soubrettes. (…) la création malheureuse et typique de ce peuple d’esthètes et de sergents qui n’a rien pu laisser dans son état naturel. (…) Une mentalité d’insulaires, fermée et orgueilleuse. Une langue qui à l’entendre paraît maigre et insignifiante, à fleur de peau. Une religion d’insectes, le culte de la fourmilière », etc.), le Japon devient en 1967 un adjuvant précieux dans l’écriture (et dans l’œuvre graphique) de Michaux [14].


試練、惡魔祓い/アンリ・ミショー著
Couverture japonaise d'Epreuves, exorcismes
1967 est aussi la date de publication des Poèmes franco-japonais de Pierre Garnier et Niikuni Seichi, ensemble poétique mêlant écriture alphabétique et idéogrammes japonais, publié à la fois au Japon et en France, dans une aventure littéraire et éditoriale restée à peu près inaperçue à l’époque et aujourd’hui oubliée mais qui n’en fut pas moins, d’après la formule de ses auteurs, la « première tentative de rapprocher, joindre et de rendre indissociables dans une même œuvre les langues japonaise et française » [15].
Mais ce n’est pas tout : c’est également à cette date que Jacques Roubaud publie son premier recueil de poésie, ε (le signe d’appartenance dans la théorie des ensembles). Il ne s’agit pas là, écrit-il, d’ « un livre au sens habituel » mais d’ « une partie de go poétique avec des pierres-sonnets ». Construit à la fois selon les principes mathématiques de Bourbaki et sur le modèle d’une partie de go, l’ouvrage de Roubaud contient 361 poèmes, soit 19x19, « de quoi occuper toutes les intersections d’un go-ban » (plateau de go). Suivront dans la foulée le Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go (Ed. Bourgois, 1969) et deux livres aux titres japonais : Mono no aware : Le sentiment des choses (Gallimard, 1970) et Renga (Gallimard, 1971).
Mono no aware porte un sous-titre éloquent : 143 poèmes empruntés au japonais. Ici, comme dans Renga, Roubaud ne prétend pas imiter un genre ni se l’approprier : il entend simplement, grâce à cet emprunt japonais, ouvrir « un autre mode de lecture », « une possibilité supplémentaire » dans son « projet de poésie » (Poésie :, Seuil, 2000). Le japonisme pictural s’est mué en un moteur poétique, fournissant aux écrivains de nouveaux outils créatifs qui se combinent avec les propres recherches formelles alors en cours en France (modèles mathématiques, jeux combinatoires, contraintes…).

Dessins du projet "Les 400 coups" pour Tokyo infra-ordinaire de Jacques Roubaud,
éditions Le Tripode
Source : ウラハイ= 裏「週刊俳句」
La même année, un autre écrivain français s’envole pour le Japon pour la première fois : il y puisera la matière de plusieurs ouvrages et d’une remise en question même de la forme-livre traditionnelle. Il s’agit de Michel Butor [16]. Enfin, c’est précisément à ce moment que Roland Barthes commence lui aussi à écrire son livre sur le Japon, L’Empire des signes. En mai 1966 en effet, il est venu, sur l’invitation de Maurice Pinguet, diriger à l’Institut franco-japonais de Tokyo un séminaire sur « l’analyse structurale du récit ». C’est à ce moment que Barthes commence à découvrir le potentiel d’un pays qui permet de « défaire notre « réel » sous l’effet d’autres découpages, d’autres syntaxes ; [de] découvrir des positions inouïes du sujet dans l’énonciation, [de] déplacer sa topologie. »
Il faut aussi noter que le Petit traité de go de Roubaud est écrit avec Georges Perec et Pierre Lusson, tandis que Renga est issu d’une collaboration avec le Mexicain Octavio Paz, l’Anglais Charles Tomlinson et l’Italien Edoardo Sanguinetti (en quatre langues : français, espagnol, anglais, italien). Primordiale, la référence japonaise n’est donc pas exclusive. Bien au contraire, elle permet une véritable rencontre des individus, des langues et des cultures. Au moment précis où Roland Barthes proclame « la mort de l'auteur » (titre d’un article de 1968) et où Michel Foucault s’interroge : « Qu'est-ce qu'un auteur ? » (conférence donnée en février 1969 à la Société française de Philosophie [17]), le travail de Roubaud anticipe en quelque sorte sur leur propre trajet – car Foucault fera bientôt un séjour au Japon, également décisif pour sa pensée – en proposant un nouveau mode d’existence, de circulation et de fonctionnement du discours poétique.

ジャック・ルーボとジョルジュ・ペレック、アンデの粉砕機、フランス
Jacques Roubaud et Georges Perec jouant au go au Moulin d'Andé, Source : Textualités
Il y a donc des années comme ça qui valent des siècles, des instants où tout s’accélère et se condense, une sorte de crête du temps où les choses prennent leur fil, leur tournure, leur vitesse, leur courbure la plus franche. Sortant d’une représentation surannée et quelque peu folklorique où un siècle de japonisme pictural – non exempt de considérations idéologiques, comme chez Michaux – l’avait peu à peu engoncé, quelques écrivains français soudain font le voyage, passent la frontière, et surtout commencent à considérer le Japon non plus seulement comme un objet de description, d’analyse, de commentaire, etc., mais comme un véritable moteur poétique.
Du réceptacle de la tradition au paradigme de la modernité, du Japon esthétisant et raffiné au Japon ludique et poétique, du Japon spectaculaire et exotique au Japon intime des petites notations quotidiennes, c’est donc toute une conception du Japon qui s’est déplacée, transformée et complexifiée, mais également les places qu’il occupe et les rôles qu’il joue dans la littérature française. Ce qui est remis en question par son biais, c’est désormais une certaine complétude, une unité substantielle – et, évidemment, largement fantasmée – de la littérature et de la pensée françaises, une certaine façon de se centrer sur elles-mêmes.

4. Conclusion
« quelque chose qui se trame et qu’on
ne peut exprimer autrement qu’en
bougeant »
(Le Clézio)
ル・クレジオ 東京日仏会館、
「芸術の非直線的展開について」18日12月2015年
JMG Le Clézio à la Maison Franco-Japonaise de Tokyo,
"Sur l'évolution non-linéaire des arts", 18/12/2015
Source : Mas Ciclismo Diary
La littérature française « au croisement des cultures » ? Mais oui, où pourrait-elle être autrement ? Mais il y a au moins deux façons de se situer au croisement des cultures, et que l’étude du japonisme en littérature sur un siècle nous permet désormais d’esquisser. La première est de désigner avec des mots une réalité extérieure ou bien de donner à voir une « réalité japonaise » plus ou moins bien reconstruite : c’est la tentation d’un certain japonisme descriptif et décoratif, plus ou moins bien informé, souvent colporteur des pires clichés, qui existe encore aujourd’hui dans la littérature française.
Une autre façon de faire, et qui existe aussi aujourd’hui – mais sans doute de manière très minoritaire – ne se contente pas simplement de produire un discours ou un savoir sur le Japon en restant délibérément au-dehors. Il n’a pas une simple fonction de dépaysement, de distraction ou de divertissement mais favorise des formes d’interfécondité et de plurilinguisme. L’écrivain ne se contente pas d’assister à un spectacle et de le retranscrire : il entre dans la danse, répondant à la définition de l’acte d’écrire que donne Jean-Marie Le Clézio dans le recueil d’entretiens regroupés sous le beau titre d’Ailleurs :
C’est un peu comme la danse. Quand on voit des gens danser, c’est très captivant, surtout si on est assis ; ça donne, comme on dit, « des fourmis dans les jambes ». Il y a quelque chose qui se trame et qu’on ne peut exprimer autrement qu’en bougeant [18].
Et, pour laisser le dernier mot à Le Clézio, cet expert – en actes et en écriture – du croisement des cultures :
Et lorsque c’est bien fait, quand on sent une bonne jonction entre le savoir-faire et l’improvisation, le désir d’agir est irrésistible.
NOTES
[1] Pour une synthèse, Lionel Lambourne, Japonisme, échanges culturels entre le Japon et l’Occident, Phaidon, 2006. Plus récemment, on citera la série d'événements Japonismes 2018 (juillet 2018-février 2019) : "trois millions de visiteurs, huit mois de programmation, 100 programmes officiels, 200 programmes associés, plus de 1800 collaborateurs", selon les organisateurs.
[2] Proust et le japonisme, Presses Univ. de Strasbourg, 1997. Voir aussi Suzuki Junji, Le Japonisme dans la vie et l'œuvre de Marcel Proust, Tokyo, Presses Univ. de Keiô, 2003.
[3] Voir tout de même la suggestive étude de Dominique Pety, Les Goncourt et la collection, De l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, 2003. Pour les monographies, Michel Wasserman, D’Or et de neige, Paul Claudel et le Japon, Gallimard, 2008. Vues synthétiques : Michel Butor, Le Japon depuis la France – un rêve à l’ancre, Hatier, 1995, Michaël Ferrier (dir.), La Tentation de la France, la tentation du Japon – regards croisés, Arles, Picquier, 2003, René de Ceccatty, « La salade d'Annette et la locomotive de Turner : petite étude sur le japonisme en littérature », in René Lalique, bijoux d'exception 1890-1912, Genève, Skira, 2007, p. 141-150.
[4] Voir René de Ceccatty, « La salade d'Annette et la locomotive de Turner : petite étude sur le japonisme en littérature », op. cit.
[5] Anthologie de littérature japonaise des origines à nous jours, par Michel Revon, Ed. Delagrave.
[6] Voir Kipling's Japan : collected Writings, Londres, Athlone Press, 1988, et en français : Lettres du Japon, Bordeaux, Elytis, 2006.
[7] Voir notamment Lafcadio Hearn, Le Japon, Mercure de France, 1993.
[8] Madame Sadayakko et Hanako n’ont guère suscité l’attention des critiques pour l’instant. Sur la première, voir Lesley Downer, Madame Sadayakko : the geisha who seduced the West, Londres, Gotham Books, 2003, et sur la seconde, qui fut le modèle de Rodin, Sawada Suketarô, Petite Hanako : l’étrange biographie de l’unique modèle japonais de Rodin, Saint-Imier, Ed. Canevas, 1997. Sur Artaud, Florence de Mèredieu, La Chine d’Antonin Artaud, le Japon d’Antonin Artaud, Ed. Blusson, 2007.
[9] Sur Perec et le Japon, voir Michaël Ferrier, « Japon mode d'emploi : Perec et le Japon », dans Japon, la Barrière des Rencontres, Ed. Cécile Defaut, 2009.
[10] Voir Le Haïkaï : les épigrammes lyriques du Japon de Paul-Louis Couchoud, La Table Ronde, 2003. Au fil de l’eau a été republié par les Éditions Mille et une nuits en 2004. Sur Paul-Louis Couchoud, on se reportera au texte de Patrick Gillet, « Paul-Louis Couchoud, Au fil du haïkaï... ». Sur le haïku, la mine de renseignements que constitue le site du haïtien français Dominique Chipot.
[11] À titre d'exemple : sur 32 numéros de La Gerbe, revue parue d'octobre 1918 à mai 1921, on trouve trois numéros qui traitent du « Haï-Kaï » : le n°9 (juin 1919), le n°25 (octobre 1920), qui y consacre un dossier, introduit un texte par René Maublanc, « Sur le Haï-Kaï français », suivi de contributions Jean Breton, André Cuisenier, Bernard Desclozeaux, Maurice Gobin, Henri Lefebvre, Jeanne Bélédin-Destranges et René Maublanc, et le n°28, qui contient « Vingt-quatre Haï-Kaï » de René Druart et un texte de Jules Romains : « À propos de Haï-Kaï » (janvier 1921). René Maublanc et René Druart y consacreront également un numéro spécial de la revue Le Pampre.
[12] « Cent visions de guerre », dont certains poèmes sont parus dès mai 1916 dans La Grande revue, a été publié à la Bibliothèque du Hérisson en 1937.
[13] Pour une étude comparée de plusieurs traductions, voir Jacques Pezeu-Massabuau, « Dans les pas du poète Matsuo Bashô », Ebisu n°38, automne-hiver 2008.
[14] J’ai étudié plus en détail cette évolution dans « La tentation du Japon chez les écrivains français », dans La Tentation de la France, la tentation du Japon – regards croisés, op. cit.
[15] Voir Marianne Simon-Oikawa, « Les poèmes franco-japonais de Pierre Garnier et Niikuni Seichi », dans L’Autre de l’œuvre, Presses Univ. de Vincennes, sous la dir. de Nakaji Yoshikazu, 2007.
[16] Voir Michaël Ferrier, « « Ruser avec la clôture » : petit portrait de Butor en volatile japonais », dans Japon, la Barrière des Rencontres, Ed. Cécile Defaut, 2009.
[17] Textes repris dans Barthes, Le Bruissement de la langue, Seuil, 1984, et Foucault, Dits et écrits, Gallimard, 1994.
[18] Jean-Marie Le Clézio, Ailleurs, entretiens de 1988 sur France-Culture avec Jean-Louis Ezine, Arléa, 2006 (1eéd. 1995), p. 25.