Hervé COUCHOT

Hervé Couchot - Photo ©M.Ferrier
Kurosawa Akira
la passion de l'observation au cinéma
黒澤明の映画における観察への情熱
Hervé Couchot, agrégé de philosophie, est professeur à l'université Sophia
de Tokyo, où il réside depuis plus d'une vingtaine d'années.
Dans ce texte dense et fourmillant de références,
il traite - en s'appuyant sur l'ensemble de l'œuvre de Kurosawa Akira -
des aspects cinématographiques de la vision requise par l’acte d’observer,
du point de vue du cinéaste et de celui du spectateur.
L'observation joue dans le cinéma de Kurosawa un rôle de premier plan dans la formation des personnages, qui sont très souvent tirés de leur état contemplatif ou de leurs rêves par une vision insoutenable, ou qui apprennent progressivement à observer le monde qui les entoure grâce à un maître qui leur ouvre les yeux sur le réel et les oblige à ne pas détourner leur regard des réalités les plus insupportables : la mort dans tous ses états, la souffrance, la misère des bas-fonds ou encore le soleil aveuglant d’une explosion atomique. Qu’est-ce qu’un cinéaste observateur et que peut apprendre le spectateur des films de Kurosawa en les observant à son tour minutieusement ?
黒澤明の映画において、観察は重要な役割を演じている。登場人物たちはしばしば、耐えがたい現実を目にすることによって、それまでの瞑想や夢から覚めることになる。死や苦しみ、最下層の生活の悲惨、原爆のまばゆい光などの耐えがたい現実から目を逸らさないことで、登場人物たちは徐々に周りの世界を観察することを学んでいく。本稿ではまた、映画監督の立場と観客や視聴者の立場から、観察という行為がどのような視点を必要とするのかを、映画という媒体の性格に即しながら検討する。観察者である監督とは何だろうか。そして、観客や視聴者は黒澤の作品を事細かに観察することによって、黒澤映画について何を学ぶことができるのだろうか。

Rhapsodie en août 「八月の狂詩曲」 (1991年)
« Observez les personnages » :
l’observation comme voie d’accès au cinéma de Kurosawa
Parue en japonais au milieu des années 1960, l’autobiographie de Kurosawa Akira se clôt par une suggestion qui s’adresse aussi bien aux spectateurs de ses films qu’aux critiques de cinéma :
« Les films sont mon véritable moyen d’expression. Pour savoir ce que je suis devenu depuis Rashômon, je pense que la meilleure façon de faire serait d’observer les personnages des films que j’ai fait depuis. » [1]
Cette recommandation laconique met l’accent sur l’importance centrale des personnages et du motif de l’observation dans la compréhension de l’œuvre du cinéaste, en même temps qu’elle réaffirme son souci de ne pas se placer dans une position de surplomb interprétatif vis à vis de ses propres films, de ne pas abuser d’autres moyens d’expression que ceux qui sont propres au médium cinématographique. On se souvient d’une formule, plus radicale encore, de l’autobiographie à travers laquelle Kurosawa identifie sa vie personnelle et son œuvre :
« Vous prenez « moi-même » et vous soustrayez « le cinéma », le résultat de la soustraction vous donnera zéro. » [2]
Elle inviterait en somme à ne pas théoriser sur mais depuis ses films, à l’issue d’un travail d’observation, si possible aussi minutieux que celui qui a prévalu à leur réalisation.
[1] Akira Kurosawa, Comme une autobiographie, trad. Michel Chion, Paris, Cahiers du cinéma, 1995, p. 306 (désormais CA).
[2] Ibid., p. 18.
À la différence de certains cinéastes qui sont d’abord passés par la critique ou qui proposent une réflexion sur l’art cinématographique dans son ensemble — les cinéastes de la Nouvelle Vague notamment ou encore Robert Bresson dans ses Notes sur le cinématographe [3] — Kurosawa se présente avant tout comme un « faiseur de films » [4] et un conteur d’histoires : « Rien n’en révèle plus sur son créateur, que l’œuvre elle-même » conclut-il dans l’épilogue de son unique livre. Bien qu’il ait écrit une autobiographie et accordé régulièrement des entretiens, Kurosawa a souvent affirmé qu’il ne possédait que le cinéma pour s’exprimer, comme Rokuchan, dans Dodes’kaden, ne se soucie que de son tramway imaginaire. Sans se montrer pour autant hostile aux interprétations proposées de ses films, il insiste par ailleurs sur son souci du concret [5] qu’il oppose aux réflexions spéculatives, aux problèmes abstraits, aux explications des cinéastes dans ou à propos de leurs films [6] :
« Je n’aime pas vraiment parler de mes films. Tout ce que j’ai à dire se trouve dans le film lui-même. Y rajouter des commentaires c’est pour moi, comme le dit le proverbe, « dessiner des pattes sur l’image d’un serpent ». » [7]
[3] Bresson n’en reste pas moins un farouche défenseur des singularités expressives a-théoriques du cinéma : « Ne pas tourner pour illustrer des thèses, ou pour montrer des hommes et des femmes arrêtés à leur aspect extérieur, mais pour découvrir la matière dont ils sont faits. Atteindre ce « cœur du cœur » qui ne se laisse prendre ni par la poésie, ni par la philosophie, ni par la dramaturgie. » (Notes sur le cinéma, Paris, Gallimard, Folio, 1975, p. 48).
[4] CA, op. cit., p. 306.
[5] « Quand je fais un film, c’est du concret. Je ne pense pas. Je fais » affirme Kurosawa.
[6] « Quand je prépare un film, j’imagine d’abord comment je le tournerais si c’était un film muet. Les personnages parlent mais ça ne doit pas être explicatif (…) Aujourd’hui, on a tendance à trop expliquer. Il ne faut pas être explicatif ». Voir également l’entretien de Kurosawa avec Kitano Takeshi, dont il aime les films parce qu’ils ne sont pas « surchargés d’explications superflues » (Takeshi Kitano, Rencontres du septième art, traduit par Sylvain Chupin, Arléa, 2003, p. 11). L’entretien entre les deux cinéastes japonais est en ligne sur Wildgrounds.
[7] CA, op. cit., p. 279-280.
Prendre au sérieux cette suggestion adressée depuis le mitan de l’œuvre ne conduit pas forcément à se réfugier dans un mutisme béat face aux images ni à renoncer d’avance à toute interprétation critique de ses films. Il s’agit bien plutôt d’opter pour une approche résolument empirique en décrivant le plus précisément possible ce que l’on observe en regardant et en écoutant les films de Kurosawa, tout particulièrement ses personnages [8]. La critique cinématographique minimaliste et a-théorique à laquelle Kurosawa semble nous convier devrait en somme rendre visible, plutôt qu’expliquer, comme ces petits projecteurs d’appoint dits « muzan » braqués dans Barberousse sur les pupilles dilatées de certains personnages féminins (tels que la jeune fille farouche arrachée à sa maquerelle par Barberousse) pour en faire ressortir la fauve étrangeté [9]. Ou encore, comme ce singulier regard fixe, dont parle à plusieurs reprises Kurosawa, et qui, à force d’endurance ouvre une brèche dans l’invisible, comme l’éclaircie déchire peu à peu une nappe de brouillard :
« Maupassant a appris aux aspirants écrivains à porter leur regard jusqu’en des domaines où personne n’y voyait quelque chose, et à en soutenir la vision, à s’obstiner jusqu’à ce qui était jusqu’alors invisible devienne visible à tous. » [10]
Il s’agirait en somme, suivant un autre proverbe japonais cité par Kurosawa dans son autobiographie, d’apprendre à observer patiemment les images des films qui défilent sous nos yeux, quitte à « regarder au plafond par un roseau creux » [11] plutôt que de se contenter d’« habits de confection » conceptuels plus ou moins bien ajustés aux contours singuliers de ses œuvres. De la même manière, Kurosawa relève que « les meilleurs scénarios comportent très peu de moments explicatifs ».
[8] Sur les enjeux de ce type d’approche, on lira avec profit la très stimulante étude d'Alain Bonfand — Le cinéma d’Akira Kurosawa, Paris, Vrin, 2011 — qui, s’inspirant du film Rêves, propose une mise en coupe filmique de son œuvre à partir de chacun des huit rêves composant cette quasi autobiographie filmée : « En construisant cet essai, j’avais à l’esprit la défiance de Kurosawa pour les théories. Il me semblait qu’il fallait, pour subsumer quelques images, respecter au plus près ces images ; ne pas les aimanter par un concept ; en tout cas épouser la prudence vers laquelle le pragmatisme de Kurosawa nous guide » (p. 18). Nous sommes très redevables à ce livre et au souci d’interprétation immanente qui anime sa démarche.
[9] Petits projecteurs qui font en quelque sorte pendant aux téléobjectifs à l’aide desquels Kurosawa fixe à leur insu les expressions du visage des acteurs au loin : « (…) dans mes films, plus le plan doit être rapproché, plus la caméra se trouve loin des acteurs. Or, avec un téléobjectif, les mouvements et les expressions du visage ressortent très nettement » (Kitano Takeshi, Rencontres du septième art, op. cit., p. 17). Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur l’importance et les enjeux de ce regard éloigné.
[10] CA, op.cit., p. 280. Voir également, au sujet de ce type de regard, la mention par Kurosawa du fondateur de la secte zen, le Bodhidarma, qui « fixa son regard sur le mur qui se dressait sur son chemin » jusqu’à ce qu’un passage apparaisse devant lui (Ibid., p.257). Cette obstination à percer une voie dans l’invisible fait penser à celle des deux vassaux, Washizu et Miki, du Château de l’araignée (1957), cherchant à franchir la muraille de brume qui leur cache la forteresse. Les techniciens chargés de filmer cette scène ont confié avoir eu toutes les peines du monde à suivre les deux acteurs fonçant au grand galop dans le brouillard.
[11] CA, op.cit., p. 78.

L'Idiot, d'après le roman de Dostoïevski
「白痴」 (1951年)
« Quand je prépare un film, j’imagine d’abord comment je le tournerais si c’était un film muet. (...) Les meilleurs scénarios comportent très peu de moments explicatifs ».
Kurosawa Akira
L’observation, comme contrepoint de la vision théorique, placerait ainsi le cinéaste, le personnage et le spectateur dans une position isotopique du point de vue de l’exercice de leurs regards respectifs [12]. Nous connaissons en effet, par de nombreux témoignages émanant de ses acteurs ou de ses assistants, le perfectionnisme légendaire avec laquelle Kurosawa a préparé ses films, imaginé ses éclairages, construit méticuleusement ses décors jusqu’à prêter main forte à ses techniciens pour obtenir l’effet souhaité, mêlant de l’encre noire à l’eau déversée en trombes (dans Rashômon et Les sept mercenaires), faisant repeindre une à une des fleurs de chrysanthème ou les hautes herbes couvrant les pentes du Mont Fuji pour en rehausser l’éclat et accentuer les contrastes (Sanjurô, Ran) [13]. Nous savons également que Kurosawa a imaginé des dispositifs d’observation originaux pour fixer notamment les expressions des visages : batteries de trois caméras filmant les mêmes scènes, téléobjectifs ou projecteurs d’appoint braqués sur les regards.
Mais il y a plus : qu’ils soient soldats ou médecins, nobles ou roturiers, la plupart des grands personnages des films de Kurosawa sont eux-mêmes des observateurs hors pair (Dersou, Barberousse) ou le deviennent suite à l’enseignement d’un maître qui leur « ouvre les yeux » et les initie aux dures exigences de l’observation. C’est par exemple le cas avec les personnages de Yano Shôgôro dans La Légende du grand Judo, Yamamoto dans Barberousse, Dersou vis à vis de Arseniev dans le film éponyme, Sato le vieux policier expérimenté de Chien enragé ou encore Sanjuro remercié par les neuf aspirants samouraïs pour leur avoir « ouvert les yeux » [14]. D’où probablement le goût de Kurosawa pour les personnages « mal dégrossis », perfectibles, pour les débutants non formés mais faits d’une étoffe telle qu’elle laisse présager des succès futurs [15].
[12] C’est le cas par exemple avec le personnage voyant de L’idiot, comparé par le metteur en scène Daniel Mesguich à une « super caméra qui dévisage tout, comme si le support était inclus dans le film » (entretien avec Charles Tesson dans les suppléments du DVD de L’idiot, collection « Introuvables »). On peut penser également à l’œil cyclopéen de Rhapsodie en août qui rappelle, au même endroit dans le ciel, l’explosion atomique de Nagasaki mais qui peut aussi être perçu comme une projection anamorphique de l’œil d’une caméra géante. Les plans d’observation entre le personnage, le cinéaste et le spectateur ne sont cependant jamais complètement équivalents. Le spectateur peut voir ce qui échappe à l’observation d’un personnage ou du réalisateur lui-même. Et vice-versa.
[13] En matière de méticulosité dans la réalisation des films, Kurosawa se dit en dette vis-à-vis de son maître, Yamamoto Kajirô, dont il a été l’assistant : « J’étais complètement abasourdi par la façon dont il était attentif aux moindres aspects de la production. Sentant que je n’étais pas capable de voir autant de choses, j’en concevais forcément des doutes sur ma capacité de mettre en scène. » (CA, op.cit., p. 210).
[14] La formule exacte est traduite ainsi en français : « Vous nous avez ouvert les yeux. Nous avons retenu la leçon. » C’est également la phrase prononcée à la fin de La forteresse cachée par le général du clan Yamana Tadokori suite à la chanson de la princesse entendue pendant la fête du feu et qui invite à « vivre sa vie en la brûlant » : « Princesse, vous m’avez ouvert les yeux. C’est décidé. Je vais brûler ma vie. »
[15] CA, op.cit., p. 216-217.
N’est-ce pas précisément à cette observation sous contrainte pouvant aller jusqu’à regarder l’horreur sous tous ses aspects, que le frère disparu du cinéaste amène son cadet lorsqu’il lui fait traverser contre son gré un champ de ruines encore fumantes où gisent des cadavres en décomposition, suite au grand tremblement de terre et à l’incendie de 1923 qui ravagèrent entièrement la ville de Tokyo [16] ? Interrompant sa description, elle-même à la limite de l’insoutenable, des corps déformés flottant sur la rivière Sumida « gonflés au point d’éclater, leur anus ouvert comme la bouche d’un gros poisson » — évocation verbale dont Kurosawa concède l’insuffisance [17] — celui qui n’est pas encore cinéaste poursuit son récit de cette excursion « aux portes de l’enfer » [18] en se rappelant un autre mot d’ordre, venant cette fois de son frère aîné :
« Si malgré moi, je détournais le regard, mon frère aîné reprenait : "Akira, regarde bien maintenant". Je ne comprenais pas où il voulait en venir, et je trouvais seulement qu’il me forçait à voir des choses épouvantables. » [19]

Un regard qui ose affronter le réel le plus cru sous tous ses aspects jusqu’à la limite du supportable.
山
田
五
十
鈴
蜘
蛛
巣
城
[16] Cette injonction à regarder un champ de ruines se retrouve par exemple dans le chant qui ouvre et clôt Le château de l’araignée (1957) : « Voyez donc. Voilà ce qui reste des rêves des hommes. (…) Ici s’élevait le château de l’araignée. » ; ou encore, au début de Barberousse, l’ordre donné au jeune médecin d’assister à l’agonie d’un patient atteint d’un cancer incurable : « Dans une vie, rien n’est plus sublime que les derniers instants. Regarde bien ». Lire sur ce sujet, l’article de Charles Tesson « Kurosawa ou l’insupportable nécessité de voir » dans Les Cahiers du cinéma (n°528, octobre 1998, p. 26-29). On peut trouver quelques rares exceptions à cette nécessité de voir l’insoutenable comme à la fin de Duel silencieux (1949), au moment où l’ancien soldat syphilitique Nakata insiste pour voir le corps difforme de son enfant mort-né et ressort définitivement prostré de la salle d’opération (« Il ne fallait pas qu’il le voie ! » s’exclame après coup le médecin).
[17] Contrairement à Akutagawa Ryônosuke relatant le même évènement et décrivant des scènes identiques, qui trouvera le mot « horreur » pleinement adéquat à la vision (Cf. Akutagawa, La vie d’un idiot, Paris, Gallimard, Folio, section 31).
[18] Cette excursion rappelle, dans la tradition bouddhique, les quatre sorties du jeune Siddharta hors du Palais Royal, rencontrant tour à tour sur son chemin un vieillard, un malade, un mort et, pour finir, un religieux. On peut d’ailleurs trouver dans le récit de Kurosawa la mention d’une statue bouddhique « dans la position du lotus », dont la forme lui est suggérée par un tas de cadavres calcinés (CA, op.cit., p. 98). « Je me rappelle avoir pensé que le lac de sang dont on parle dans l’enfer bouddhiste ne pouvait pas être pire » constate t-il.
[19] Dans la partie de son reportage sur Ran intitulée « Laque et or » (AK, 1985), Chris Marker, relisant le même extrait de Comme une autobiographie sur fond d’images d’archives, établit un lien direct entre cet épisode traumatique de la biographie et le souci du cinéaste de montrer la mort physique sans détours, dans toute son atrocité. Voir également, toujours à propos de Ran, Serge Daney qui rappelle l’importance formatrice de cette scène et de l’« impératif catégorique » qui en découle : « il faut regarder ce qui nous déborde de partout, faire jeu égal avec le monde. Et qu’est-ce que le monde, sinon une catastrophe ? » (Ciné journal, volume II (1986), Paris, Cahiers du cinéma, coll. Petite bibliothèque, 1998, p. 218).
Yamada Isuzu Le château de l'araignée (1957)
Cette expérience visuelle initiatique « terrible, effrayante mais d’une importance capitale », aux dires mêmes du cinéaste, et qui agit au sens fort comme un « souvenir-écran », mêlant les réminiscences biographiques aux images dans certains de ses films [20], présuppose de fait un type spécial d’observation, un regard qui ose affronter le réel le plus cru sous tous ses aspects jusqu’à la limite du supportable. On peut penser ici, en guise de contrepoint philosophique, à l’histoire de Leontios telle que la relate Platon dans le quatrième livre de la République, même si elle illustre davantage la faiblesse de l’homme en proie à un désir morbide, du côté du philosophe, là où le cinéaste en tire une leçon de courage et de vérité [21].
Sans se porter toujours à ses extrêmes, qui doivent pourtant être restitués le plus précisément possible par des mots ou, à défaut, par des images, le spectateur-observateur exercerait donc son tour le même type de regard que celui du cinéaste produisant ses films et façonnant ses personnages observateurs. Il se trouverait du même coup soumis à la même injonction que nous décrirons ultérieurement plus en détails : observez d’abord, ne théorisez pas et surtout ne détournez jamais votre regard du réel [22], même lorsqu’il est insoutenable.
C’est à cette valorisation de l’observation sous contrainte qui, chez Kurosawa, transcende les différences d’époques et de genres, ainsi qu’aux principaux personnages-observateurs de ses films que cette étude entend essentiellement se consacrer.

[20] La notion de souvenir-écran renvoie à un concept forgé par Freud à l’occasion de son auto-analyse et étudié ultérieurement dans un article de 1899 : « Souvenirs d'enfance et souvenirs-écrans ». La conservation dans la mémoire de ce type de souvenirs, souvent très anciens, s’explique selon lui par un processus de déplacement consécutif à un rapport d’association entre un souvenir souvent indifférent et un autre, plus important, dont le contenu est refoulé. Kurosawa évoque très précisément ce type de souvenirs à propos d’une « réminiscence éclair » tardive qui lui permet de comprendre l’origine personnelle du personnage de l’avocat Hiruta dans Scandale (CA, op.cit., p. 291). On trouve également une trace de ce télescopage entre la biographie et le cinéma dans l’épisode de Rêves au cours duquel l’éruption du Fuji provoque l’explosion d’une centrale nucléaire : « Dans mon entourage, il y eut un homme qui racontait, apparemment convaincu que ces bruits (les déflagrations d’un arsenal incendié contenant des explosifs) provenaient des volcans en éruption sur la péninsule d’Izu » (Ibid., p. 94-95). Pour d’autres exemples d’anamnèses autobio-cinémato-graphiques, voir l’étude d'Alain Bonfand (op.cit., p. 45-46).
[21] « Il m'est arrivé, repris-je, d'entendre une histoire à laquelle j'ajoute foi : Léontios, fils d'Aglaïon, revenant un jour du Pirée, longeait la partie extérieure du mur septentrional lorsqu'il aperçut des cadavres étendus près du bourreau ; en même temps qu'un vif désir de les voir, il éprouva de la répugnance et se détourna ; pendant quelques instants il lutta contre lui-même et se couvrit le visage ; mais à la fin, maîtrisé par le désir, il ouvrit de grands yeux, et courant vers les cadavres : « Voilà pour vous, mauvais génies, dit-il, emplissez-vous de ce beau spectacle ! »». Platon, République, Livre IV, 439e-440b, traduction Robert Baccou). Avant Kurosawa et sur le plan romanesque, Dostoïevski, dans L’idiot tirera lui aussi d’un récit-tableau analogue (le spectacle d’une exécution capitale par l’idiot) une expérience de vérité et d’observation extrêmes : «Voilà un individu qui a une verrue sur le front ; tiens il y a un bouton rouillé dans le bas de la redingote du bourreau. » (L’idiot, livre I, chapitre 4, p. 188). De ce point de vue, le personnage observateur de l’idiot se présente comme un anti-philosophe comme le lui fait remarquer Adelaïde, la puînée de la générale : « (…) il vous suffit de vous mettre à raconter quelque chose pour vous départir de votre philosophie ».
[22] C’est très souvent le conseil ultime adressé par le maître ou par un initiateur plus expérimenté au novice en observation, comme dans Chien enragé, le conseil donné par Satô à son jeune collègue policier Murakami visant à le tirer de ses réflexions sur l’injustice de la société : « Regarde par la fenêtre ». On trouve également la même situation et la même injonction dans Les salauds dorment en paix, avec le comptable Wada contraint par Nishi d’assister à ses propres funérailles, suite à son suicide simulé, et d’écouter les propos cyniques échangés la veille à son sujet par les deux cadres véreux de la compagnie Dairyu.
La place de l’observation :
qu’est-ce qu’observer au sens de Kurosawa ?
Le verbe « observer » peut se traduire de plusieurs façons en japonais suivant la situation ou le type de regard privilégiés. Il est utilisé dans la traduction française de certains dialogues, par exemple dans La légende du grand judo au moment où Sugata Sanshirô, pour comprendre en quoi consiste la voie de l’homme, passe toute une nuit plongé dans l’eau glaciale d’un étang, agrippé au « pieu de la vie », à observer la pleine lune et, au petit jour, une fleur de lotus en train d’éclore ; on retrouve cette injonction à observer dans Barberousse au début de la scène, également initiatique, de l’opération à l’occasion de laquelle le jeune médecin Yasumoto doit assister son aîné dans une intervention chirurgicale, pratiquée sans anesthésie, sur une jeune ouvrière blessée aux hanches et au ventre : « Ne tourne pas la tête. Observe bien cette suture » [23].
Il existe également en japonais un autre verbe — « niramu » 睨む [24] — pouvant être traduit par « regarder fixement » ou « regarder dans les yeux » et qui peut être employé pour rendre compte de ce type spécial de vision non théorétique ; c’est ce verbe qui est utilisé par le vieux révérend de l’école du judo, dans La nouvelle légende du grand judo (1945), pour essayer de tirer Sugata Sanshirô de ces réflexions obsessionnelles : « arrête de déblatérer et regarde fixement ce qui t’obsède jusqu’à ce que ton obsession disparaisse. » [25]
On retrouve ce type de regard dans Madadayo à travers l’anecdote du cheval croisé par le vieux professeur au « cœur d’enfant » devant la devanture d’une boucherie où il vient tout juste d’acheter de la viande de cheval :
« Il m’a fixé de ses grands yeux en amande avec l’air de dire : « Maître, qu’êtes vous venu acheter ici ? ». J’étais très gêné. Vraiment ! J’aurais voulu me cacher. Savez-vous que les yeux des chevaux sont immenses ? »
[23] Il s’agit en fait de la seconde scène initiatique qui fait appel à l’observation clinique de la souffrance ou de la mort, juste après l’agonie de Rokusuke en phase terminale d’un cancer du pancréas et que Barberousse lui demande de veiller : « Il n’est de plus bel instant que celui de la mort. Regarde bien. »
[24] Niramekko にらめっこ désigne en japonais le jeu de regards des enfants correspondant à notre « qui rira le premier ».
[25] Dans les sous-titres français de l’interprète Catherine Cadou.
Savez-vous que les yeux des chevaux sont immenses ?

Certes, dans les dialogues originaux en japonais, c’est le plus souvent le verbe « miru » 見る (voir) et non le verbe « kansatsu suru » 観察する (observer) qui est utilisé ; mais si la traductrice a jugé préférable d’utiliser, dans la scène de Barberousse, le verbe « observer » c’est à l’évidence pour rendre compte d’un regard spécial irréductible à la contemplation, car il ne porte pas sur des formes idéales, et qui ne se réduit pas simplement à la perception visuelle [26].
Ainsi dans Rêves, le peintre Van Gogh ne voit pas le paysage qui se trouve devant son chevalet mais il l’observe de telle sorte qu’il finisse par se peindre en lui-même, comme le paysage hors champ que cherche à restituer, dans toute sa vérité, le peintre Aoya Ichirô dans Scandale, et qui constitue une antithèse à la falsification photographique.
D’autre part, on pourrait dire de certains personnages qu’ils ont des yeux pour voir et regarder mais qu’ils n’observent pas. Vladimir Arseniev est, dans Dersou Ouzala, l’archétype de ce personnage, lui pour qui la taïga est d’abord une étendue à mesurer et un espace à parcourir à l’aide de cartes [27]. Il en va de la même avec le jeune apprenti-médecin de Barberousse qui possède une connaissance essentiellement livresque de son art, grâce aux traités de médecine hollandais qu’il a lus pendant ses études. Géomètres ou férus de théories, ces anti-observateurs dont la « myopie » contemplative contraste avec le « regard d’aigle » de leurs aînés, se trouvent pour ainsi dire logés à la même enseigne que « la grenouille dans son puits », pour reprendre un autre proverbe japonais mentionné par Kurosawa dans son autobiographie [28]. Arseniev, arpentant en compagnie de Dersou la calotte d’un lac gelé pour prendre des mesures, ne voit pas venir le danger de mort que représente une nuit passée en extérieur sous un vent glacial.
Inversement, on voit des personnages faire preuve d’un sens aigu de l’observation même lorsqu’on n’y voit presque rien, par exemple dans des conditions météorologiques défavorables (pluies diluviennes, brouillards à couper au couteau, tempêtes de neige, soleils aveuglants), des mouvements de foule (la scène du match de base-ball dans Chien enragé), ou des taillis épais (Le château de l’araignée, Rashômon, le premier des Rêves). Paradoxalement, il arrive souvent que des conditions extrêmement défavorables à la vue stimulent et distinguent le bon observateur davantage qu’elles ne le contrarient.
L’observation peut certes requérir une perception visuelle détaillée mais elle ne s’y réduit pas ; elle n’exclut d’ailleurs pas les hallucinations, omniprésentes dans de nombreux films de Kurosawa, y compris chez les personnages les plus « réalistes », ni même le rêve par lequel un personnage s’évade momentanément de l’enfer, comme le jeune couple d’amoureux d’Un merveilleux dimanche ou les parias des Bas-fonds [29]. Encore faut-il conserver un souvenir suffisamment précis de ses rêves pour en reconstruire le récit. Même dans leurs rêves, hallucinations ou folies monomaniaques, les personnages de Kurosawa continuent à observer précisément les réalités qui aimantent leurs regards, fussent-elles les plus modestes (jouets, visages, fleurs ou insectes) ou les terrifient : ainsi le parchemin vierge que lit Benrei dans Les hommes qui marchèrent sur la queue du tigre, déclenchant une peur panique chez le porteur naïf, la lame de couteau ou la flamme des chandelles à la fin de L’idiot, ou les gerbes de flèches qui s’abattent sur Washizu dans Le château de l’araignée. Les images de l’hallucination la plus délirante requièrent elles aussi un sens de l’observation tout aussi aigu que celles de la réalité ambiante, comme on le voit bien avec les personnages de Dodes’kaden : Rokuchan inspecte soir et matin l’état de son « vieux » tramway, pestant contre la négligence de mécaniciens imaginaires et le clochard a lui-même une vision très précise de la villa somptueuse qu’il souhaite construire pour son fils, au point de la décrire dans ses moindres détails et sous toutes ses coutures (arabesques du portail, surface de la véranda, style écossais du salon ou forme de la piscine). De même, dans Un merveilleux dimanche, le jeune homme décrit à sa fiancée les musiciens composant un orchestre imaginaire sur le point d’interpréter la Symphonie inachevée de Schubert.
Madadayo 「まあだだよ」(1993年)
[26] Remarquons ici que contrairement à la langue française, le japonais ne sépare pas nettement, par deux verbes différents, « voir » et « regarder ». Voir, regarder et même observer peuvent fort bien être traduits par le même verbe (« miru » 見る). Un autre verbe « mieru » / 見えるpourra malgré tout rendre compte d’une dimension plus passive de la vision lorsqu’elle a affaire à des choses visibles qui se présentent à nous sans intention de les regarder.
[27] Serge Daney a analysé, du point de vue de leurs regards respectifs, cette opposition entre le contemplatif formé par un savoir livresque (cartes, traités de géométrie ou de médecine) et l’observateur attentif à son milieu de vie ambiant qui revient si souvent dans les films de Kurosawa, quels qu’en soient le genre ou l’époque : « L’œil du géographe voit large mais l’œil du chasseur voit juste (au sens où un vêtement est large ou juste) ( …). L’erreur d’Arseniev, sa déformation professionnelle c’est qu’il n’existe pour lui qu’un espace, celui que lui donne la géométrie. » (« Un ours en plus », La rampe, 1996, Paris, Cahiers du cinéma, coll. Petite bibliothèque, p. 102 sq.).
[28] CA, op. cit., p. 78.
[29] Même si les rêves et les illusions aident les personnages à supporter l’enfer de leur vie (Un merveilleux dimanche, Les bas-fonds, Dodes’kaden), le motif du regard qui doit affronter la réalité en face, jusque dans la mort, se retrouve dès le début du film à travers la recommandation adressée par le pseudo samourai à la jeune fille perdue dans ses songes (Osen) : « Rêver ne fait pas de bien. Regarde les choses en face. ». C’est également le reproche qu’adresse Yuzo à sa fiancée Masako au début d’un « dimanche à 32 yens », dans Un merveilleux dimanche, bien qu’il finisse à son tour par composer avec la part du rêve : « Tu n’es pas réaliste. Tu vis dans un rêve. Tu dois faire face à la réalité pour pouvoir vivre dans un monde comme celui-là. ». Dans Dodes’kaden, l’artisan Tamba qui, à près de vingt ans d’intervalle constitue un réplique du vieux sage des Bas-fonds, tente de trouver un compromis entre les nécessités vitales de l’illusion et celles de la lucidité, entre les affres de la réalité la plus sordide et l’évasion que favorisent les rêves, permettant d’espérer en des lendemains meilleurs. Inversement et faute d’avoir pu quitter le monde de la pure illusion, le père clochard de Dodes’kaden ne réalise la gravité de l’intoxication alimentaire de son fils qu’au moment de sa mort.
Le château de l'araignée
「蜘蛛巣城」 (1957年)
Il est de fait assez rare, dans le monde cinématographique de Kurosawa, que les observateurs les plus lucides ne passent pas eux-mêmes par une phase hallucinatoire ou onirique. Il serait certes possible de parler à leurs sujets de « moments contemplatifs » mais pas au sens de la « theoria » platonicienne dans la mesure où les personnages sont toujours absorbés par des réalités qui relèvent du monde sensible, humain ou naturel, même lorsqu’elles sont imaginaires. Si, comme le philosophe Gilles Deleuze, on peut parler de métaphysique à propos des problèmes qu’ils se posent ou dans certaines scènes d’angoisse [30], il ne peut s’agir d’une métaphysique idéaliste de type platonicien. Les formes qu’ils observent sont en effet soumises au changement, comme le disque nacré de la lune ou la corolle d’une fleur de lotus en train d’éclore. Ce sont davantage des puissances phénoménales ou des événements qui relèvent d’une physis au sens étymologique de ce terme — littéralement ce qui éclot dans la présence et s’y épanouit [31] — plutôt que des formes géométriques éternelles, situées dans un ciel sublunaire tout aussi idéal [32]. Dans le monde cinématographique de Kurosawa, le soleil lui-même est moins une sphère parfaite qu’une masse de feu irradiante, naturelle ou atomique [33], un incendie permanent qui peut dévorer la terre. L’œil qui a le courage de la regarder en face et sans écran risque à tout moment de s’aveugler.
On pourrait du même coup distinguer chez Kurosawa deux manières d’observer, pouvant parfois coexister dans les mêmes personnages, mais qui toutes deux se distinguent de la contemplation : une première façon d’observer consisterait à explorer les surfaces, à suivre les mouvements et les changements d’une situation, d’un milieu, d’une force qui affecte les personnages eux-mêmes. C’est très manifestement celle dans laquelle excelle Dersou, le vieux chasseur au regard d’aigle de la taïga, ou les policiers enquêteurs dans Chien enragé et Entre le ciel et l’enfer. Un autre type d’observation impliquerait davantage un regard fixe, plus « radiographique », traversant les corps ou sondant les cœurs. Un tel regard focalisé sur un point de fuite unique plus ou moins vaste que le champ de la vision peut fort bien dégager une impression de vague, comme celui des idiots. Le regard du porteur simplet des Hommes qui marchèrent sur la queue du tigre est de ce type, comme celui de Kameda dans L’idiot ou de Rokuchan dans Dodes’kaden. Le personnage de Barberousse semble alterner entre ces deux types d’observation, suivant les situations auxquelles le médecin-samouraï doit faire face : opération chirurgicale, entretiens en tête à tête avec des malades ou avec son disciple, combat contre les maquereaux dans la cour du bordel à qui il enlève la jeune « muette ».
On trouve dans les films de Kurosawa plusieurs types de regards correspondant, pour certains, à des plans bien précis : regards fixes hallucinés, terrifiés, monomaniaques ou regards de fous prostrés, regards panoramiques (dans certaines scènes de combats), regards qui auscultent les corps ou les visages pour y lire des souffrances invisibles au plus grand nombre (comme celui de Kameda dans L’idiot) ; ou encore regards-traveling des enquêteurs qui dévisagent les passants ou balaient les foules à l’occasion d’une filature (Un chien enragé, Entre le ciel et l’enfer). Parfois c’est un traveling qui enfile les regards comme des perles. Ainsi en va-t-il avec le défilé des visages ébahis ou hostiles des paysans dans Je ne regrette pas ma jeunesse (1946) au moment où Yukie, l’épouse de l’activiste pacifiste considéré comme traitre à sa patrie, décide d’emprunter le chemin bordé de haies qui traverse le village. L’œil seul qui regarde avec ou sans prothèse optique [34] peut d’ailleurs occasionnellement apparaître indépendamment de tout rapport avec un personnage, comme dans Rhapsodie en août. Le cinéma de Kurosawa est un cinéma dans lequel le regard doit être à son tour regardé, où l’œil doit parfois être sur-éclairé pour pouvoir être observé par le spectateur [35].
[30] Sur les relations possibles entre le cinéma de Kurosawa et la description phénoménologique de l’angoisse chez Heidegger, voir Alain Bonfand (Le cinéma de Kurosawa, op. cit., p. 40, 103, sq.).
[31] Sur cette approche d’un sens originaire, pré-philosophique, de la « physis », on relira les analyses de Heidegger dans son Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, p. 25-26.
[32] Dans le sillage des encyclopédistes qui opposent nettement l’observation et l’attitude théoricienne (voir l’article « observation » dans la 1ère édition de l’Encyclopédie), le naturaliste et météorologue suisse Jean Servier (1742-1809) présente ainsi les particularités de l’observation : « L'art d'observer est moins l'art de penser que celui d'apercevoir ; il serait une logique pour les sens qui enseignerait plus particulièrement Ieurs opérations, leurs usages (…). En un mot, ce serait l'art d'être toujours en rapport avec les circonstances qui intéressent, de recevoir les impressions des objets comme elles s'offrent à nous, et d'en tirer les inductions qui en sont les justes conséquences. » (Jean Servier, Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences, Genève, éditions Paschoud, 1802, T.1, p. 6).
[33] On pense ici à la scène finale de Vivre dans la peur et au 5ème des Rêves intitulé « les corbeaux », minutieusement analysés par Alain Bonfand en relation avec la phénoménalité heideggerienne de l’angoisse (Le cinéma de Kurosawa, op. cit., p. 105-114). Au sujet de l’affrontement incessant de ces deux soleils, il faudrait relire les deux articles intitulés « Soleil pourri » et « La mutation sacrificielle et l’oreille coupée de Van Gogh » dans les Documents de Georges Bataille (Paris, Mercure de France, 1968, p. 115-118 et 145-163). Bataille évoque également cette relation au soleil tragique et la « sagesse éclairée des « sages » qui n’a pas toujours raison contre la sagesse aveugle des peuples » à propos de la double explosion nucléaire de Hiroshima et Nagasaki : « À celui qui dans les rues de Hiroshima fut ébloui par un éclair immense, qui avait l’intensité du soleil et n’était pas suivi de détonation, la colossale explosion n’apprenait rien. Il la subissait comme un animal. Il n’en connut même pas l’étendue gigantesque. » (« À propos de récits d’habitants d’Hiroshima » (1946), Œuvres complètes, tome 2, p. 172-187).
[34] Les appareils optiques (microscopes, appareils photos, lunettes d’observation ou de tirs, instruments de géomètres, appareils radiographiques, etc.) occupent une place de choix dans plusieurs films de Kurosawa, au point parfois de participer directement à l’intrigue tels de véritables personnages. C’est notamment le cas avec le microscope qui permet de vérifier les lentilles de canons aériens dans Le plus beau, l’appareil photographique de Scandale, les radiographies de L’Ange ivre et de Vivre ou encore le fusil à lunettes offert par Arseniev à Dersou pour sa survie mais qui, tel un pharmakon, lui sera fatal.
[35] On peut penser ici à l’éclairage singulier utilisé par Hitchcock des yeux de Janet Leigh, dans la scène de Psychose (1960) où elle conduit une voiture sous des trombes d’eau qui la forcent à observer plus attentivement les phares des voitures qu’elle croise, juste avant d’arriver au funeste motel des Bates. Les yeux qui observent sont eux-mêmes mis en relief par une lumière d’appoint qui accentue leur expression démoniaque.

« Faire attention à quelque chose ne veut pas dire river son regard dessus, mais en être conscient de façon naturelle. C’est ce que le dramaturge et théoricien du nô Zeami appelle, je crois, « voir avec un regard détaché ». »
Kurosawa Akira
L'ange ivre 「醉いどれ天使」 (1948年)
Dans tous les cas, l’observation n’est pas simplement affaire de vision exhaustive ni de voyance [36]. Nul besoin en effet de tout regarder pour bien observer ni même parfois de voir au sens d’une perception visuelle. Un aveugle pourra manifester un sens tout aussi aigu de l’observation, comme le célèbre masseur itinérant Zatōichi passé maître dans l’art du sabre. Dans Kagemusha, le tireur embusqué qui blesse mortellement Shingen affirme qu’il ne voyait rien car la nuit était trop sombre. Pourtant il atteint sa cible en regardant de jour la position du général puis en tirant à l’aveuglette [37].
Par son expérience de cinéaste, Kurosawa a acquis la conviction qu’un bon observateur ne doit pas s’attacher à fixer du regard les moindres détails d’un plan mais en avoir une vue d’ensemble en même temps qu’une conscience précise :
« Dans le tournage d’une scène, l’œil du réalisateur doit veiller au moindre détail. Mais cela ne veut pas dire qu’il doit fixer le plateau d’un regard concentré (…). Faire attention à quelque chose ne veut pas dire river son regard dessus, mais en être conscient de façon naturelle. C’est ce que le dramaturge et théoricien du nô Zeami appelle, je crois, « voir avec un regard détaché ». » [38]
Dans sa relation aux téléobjectifs, l’acteur qui se sait filmé mais qui ignore par quelle caméra il est filmé se trouve logé à la même enseigne que le cinéaste : il ne sait pas plus d’où il est filmé que ce qui est filmé de lui.
Sur le plan des images, l’observation minutieuse n’implique pas toujours une différenciation nette entre la perception réelle et la vision imaginaire, qui cohabitent très souvent chez Kurosawa jusque dans sa façon de filmer les rêves ou les hallucinations, au point qu’ils sont parfois indiscernables des situations « réalistes ».
En dehors du nô, dont le cinéaste japonais était un grand connaisseur, l’observation telle qu’elle est pratiquée par les personnages de Kurosawa fait davantage penser à une façon spéciale de voir sans regarder décrite par le célèbre maître d’escrime Miyamoto Musashi dans son Traité des cinq roues (Go rin no sho) [39]. Non seulement Musashi préconise, en amont de l’affrontement, une observation détaillée de la tactique de l’adversaire et de la topographie des lieux de combats [40], mais encore il décrit à plusieurs reprises la façon dont le combattant doit user de ses yeux en fonction des circonstances — affrontements individuels ou oppositions de troupes — et de l’option tactique qu’il choisit. L’important, dans tous les cas de figure, est de « ne pas avoir les yeux fixés trop étroitement » sur telle ou telle partie du corps de l’adversaire ni sur son sabre mais d’arriver à « les voir sans les regarder ». Il ne s’agit donc ni de « contemplation », ni d’« intuition », au sens métaphysique de ces termes — dès lors que le terrain de l’affrontement est un champ d’empiricités soumis aux vicissitudes du temps — ni même simplement d’une vision générale puisque cette « fixation vaste » des yeux, requise par les combats, implique une saisie simultanée de tous les paramètres de l’affrontement, une vision de « la force et de la faiblesse de chaque instant. ». Cette analyse paraît clairement en phase avec celles de Zeami et de Kurosawa au sujet de leur arts respectifs : « Faire attention à quelque chose ne veut pas dire river son regard dessus, mais en être conscient de façon naturelle. ».
L’observation qui pourrait être, en ce sens, une façon détaillée de voir sans regarder [41], une vision à la fois fixe et ample, peut-être dans certains combats une question de vie et de mort. D’où l’importance de s’y exercer sans relâche. Son acuité résulte la plupart du temps d’un lent et rigoureux apprentissage, comme celui des acrobates auxquels Musashi compare les bons escrimeurs :
« Tous n’ont pas les yeux fixés sur les objets qu’ils traitent car leurs mains y sont habituées et exercées tout au long des jours. Ils voient sans regarder. » [42]
Il faut dès lors toute une série de conditions préalables pour commencer à observer au sens fort ce que l’on voit ou ce que l’on regarde. N’est pas observateur qui veut.
[36] Il en va de même pour les scènes fantastiques, comme dans Rêves la rencontre d’un personnage avec des démons gémissants ou la conversation avec une armée de morts-vivants sortant d’un tunnel. Dans ses Lumières pour enfants, le philosophe Walter Benjamin suggère que même les créatures fantastiques et démoniaques d’Hoffmann sont nées de son sens aigu de l’observation des réalités qui l’entouraient, au point que ce dernier « n’a pas tiré l’extraordinaire du néant mais de l’observation des gens, des choses, des maisons, des objets, des rues, etc. » et qu’il « était moins un voyant qu’un regardant » (Lumières pour enfants, Paris, Christian Bourgois, trad. Sylvie Muller, 1988, p. 42-43). Du côté de la culture japonaise, mon ami, l’écrivain Michaël Ferrier, me signale la création à Tokyo d’une école artistique et scientifique d’observation de la rue qui explore notamment les déviances architecturales de cette ville (voir son texte « Rojô kansatsugakkai 路上観察学会 » dans l'Encyclopédie de la spatialité japonaise, sous la dir. de Philippe Bonnin, Nishida Masatsugu et Inaga Shigemi, Paris, CNRS, 2014).
[37] Sur le paradoxe d’une cible atteinte sans visée, voir l’ouvrage classique du philosophe allemand Eugen Herrigel, Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, Paris, éditions Dervy, 1970.
[38] CA, op. cit., p. 314. À propos de Zeami, on peut traduire également par « regard éloigné » comme le fait Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage éponyme, qui emprunte sciemment cette notion pour décrire la position d’observateur spécifique à l’ethnologue (Claude Lévi-Strauss / Didier Éribon, De près et de loin, Paris, Odile Jacob, 1988, p. 249) : « [Pour un acteur de nô] Voir selon le point de vue [objectif] d’un regard éloigné 離見の見 c’est comprendre le regard du spectateur. » (Zeami Kakyō, Le miroir de la fleur (1424) in La tradition secrète du nô, Paris, Gallimard / Unesco, 1960, p. 119-120). Le « riken no ken », ou « regard du regard éloigné », qui permet à l’acteur de nô de se voir de loin et même de dos est distingué par ce penseur du « gaken », littéralement le regard qui porte le moi ou « personnel ». Sur la découverte du nô et la lecture par Kurosawa des écrits de Zeami, voir CA, op. cit., p. 241-243.
[39] Ce ouvrage célèbre, rédigé vers 1645, est mentionné par Kurosawa dans son autobiographie (CA, op. cit., p. 77) en même temps que d’autres traités de grands maîtres du sabre (ibid., p. 53).
[40] Miyamoto Musashi, Traité des cinq roues, Paris, Albin Michel, 1983, trad. Shibata, Livre IV, p. 100-101. Ainsi, dans la Nouvelle légende du grand judo (1945), Sugata Sanshiro sonde-t-il la profondeur de l’eau à différents endroits, depuis le parapet d’un quai, avant d’y propulser le marin américain qui l’a défié à la boxe.
[41] Sur la distinction entre la vue et le regard, lire également le chapitre consacré à la position des yeux dans la tactique (Ibid., p. 74-75) : « Entre voir et regarder, voir est plus important que regarder. L’essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme si c’était proche et de voir ce qui est proche comme si c’était éloigné. ».
[42] Ibid., p. 133.

« Tous n’ont pas les yeux fixés sur les objets qu’ils traitent car leurs mains y sont habituées et exercées tout au long des jours. Ils voient sans regarder. »
Les acrobates, les escrimeurs
et les cinéastes
selon Kurosawa
Chien enragé 「野良犬」 (1949年)
L’apprentissage et l’épreuve de l’observation
Dans le cinéma de Kurosawa, on ne naît pas observateur. On le devient, le plus souvent au terme d’un apprentissage contraint et forcé. Certes, l’observation peut être pensée comme un simple préalable à l’action réussie [43], en particulier pour les scènes de combats collectives ou individuelles (dans La légende du grand judo I et II, Sanjuro, Yojimbo, Kagemusha, Ran) qui requièrent en amont toute une connaissance détaillée de la situation, une prise en compte du terrain de l’affrontement et des particularités tactiques de l’adversaire. Malgré tout, on trouvera dans plusieurs films de Kurosawa une certaine autonomie des scènes d’observation qui peuvent fort bien être concomitantes ou consécutives à des scènes d’action, jusqu’à les absorber parfois pour former une sorte d’action-observation. C’est particulièrement net dans l’un des premiers films de Kurosawa, Le plus beau, dans lequel une lentille de précision destinée à un viseur de canon aérien, non vérifiée puis égarée par la chef des ouvrières, Watanabe Tsuru, va être à l’origine de la séquence la plus dramatique du film. Redoutant que ce moment d’inattention ne coûte la vie aux soldats qui pourraient l’utiliser, Watanabe va passer une nuit entière à vérifier près de deux mille lentilles faisant de l’observation au microscope une véritable épreuve d’endurance patriotique en même temps qu’une question de vie ou de mort pour les soldats qui seront amenés à l’utiliser. Ce motif se retrouve, à peine transformé, dans l’épisode du fusil a lunettes offert par Arseniev a Dersou pour qu’il puisse continuer à vivre dans la taïga en dépit de sa vue qui baisse et qui sera indirectement cause de sa mort (Dersou sera assassiné par des voleurs qui convoitaient sa carabine). D’une certaine manière, toute l’action dramatique de L’idiot tient également dans un certain jeu de regards échangés par les quatre personnages principaux, Kameda, Akama, Taeko et Ayako. Comme dans une sorte de « à qui rira le premier » tragique, il s’agit sans cesse de scruter le regard de l’autre pour essayer de percer à jour le malheur qui l’habite ou l’intensité de ses sentiments. Enfin, on trouve des personnages observateurs qui ne participent pas directement à l’action, en particulier les enfants (Entre le ciel et l’enfer, Rêves, Rhapsodie en août). Nous y reviendrons.
[43] On peut penser ici aux analyses du cinéma de Kurosawa proposées par Gilles Deleuze dans le cadre d’une analyse de l’« image action ». Pour le cinéaste qui tourne son film comme pour le personnage qui s’apprête à passer à l’acte, « il faut connaître toutes les données avant d’agir, pour agir » (Gilles Deleuze, L’image mouvement, 1983, Paris, Minuit, chapitre 11, p. 256 sq.). Deleuze est cependant sensible, chez Kurosawa comme chez Dostoïevski, à l’existence d’une question urgente enveloppée dans la situation « que le héros doit dégager pour pouvoir agir » (Ibid.). Nous verrons que cette question porteuse, selon le philosophe, d’un souci métaphysique (comme mise en suspens et dépassement d’une situation donnée) et qui interrompt momentanément le cours d’une action peut aussi coïncider avec un problème d’observation.

Le plus beau 「一番美しく」(1944年)
On peut distinguer chez Kurosawa deux façons de devenir observateur : celle qui résulte d’une épreuve et celle qui s’acquiert plus graduellement, à l’aide d’un maître ou d’un aîné plus expérimenté, au terme d’un apprentissage souvent douloureux, supposant également toute une série d’épreuves : on pourrait parler ici d’une sorte de paideia platonicienne à l’envers, au terme de laquelle il s’agit pour un novice de passer de la contemplation à l’observation, le plus souvent en affrontant un milieu hostile. La clinique du docteur Barberousse et la taïga de Dersou sont de ce point de vue des anti-académies platoniciennes : nul n’y reste s’il n’est prêt à devenir observateur.
Parmi les multiples difficultés auxquelles l’apprenti observateur doit faire face, il faut mentionner la place particulière réservée aux météos catastrophiques ou aux conditions de lumières extrêmes, même si le déchaînement des éléments possède par ailleurs une certaine autonomie plastique par rapport à l’intrigue des films, constituant des sortes d’événements-drames par eux-mêmes, comme le suggère A. Bonfand [44]. On a souvent souligné, à juste titre, que Kurosawa, contrairement à Ozu, était le cinéaste des météos catastrophiques [45] — trombes d’eau, tempêtes de neige, brouillards épais, bourrasques de vent cinglant les visages, nuages de vapeur, etc. — et, comme son peintre préféré, Van Gogh, des lumières extrêmes — soleils aveuglants ou ténèbres — qui vont parfois de pair, comme dans les derniers tableaux du maître hollandais ou dans certains plans des bas-fonds de Dodes’kaden. Dans Chien enragé, le détective Sato ironise sur la quasi impossibilité de trouver un criminel lorsqu’il pleut des cordes mais c’est pourtant au terme d’une journée continuellement arrosée par des trombes d’eau que le criminel sera arrêté, après avoir été identifié par les traces de boues qui maculent ses chaussures et ses bas de pantalon. De la même manière, dans la scène finale de Rhapsodie en août, les enfants partent à la recherche de la grand-mère sous une pluie battante qui ralentit leur course et gêne la vision.
[44] Alain Bonfand, Le cinéma d’Akira Kurosawa, op. cit., p. 21-23.
[45] « John Ford quand il rencontra Kurosawa lui dit : « vous aimez vraiment la pluie. » Et Kurosawa répondit : « vous avez bien regardé mes films ». » (propos cités notamment par Alain Bonfand, op. cit., p. 16). Sur les différentes météos de prédilection de quelques grands cinéastes japonais, voir Hasumi Shigehiko (Ozu, Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 187) : « Rappelons que la brume est un élément de décor indispensable à Kenji Mizoguchi ou qu’on ne saurait imaginer les films d’Akira Kurosawa sans la pluie. La canicule du Chien enragé a son pendant dans le froid de L’idiot. »
Il semble que chez Kurosawa, on n'observe véritablement bien que dans la difficulté à voir, dans des conditions météorologiques, des types de lumière ou des environnements nécessitant une véritable ascèse du regard, comme l’enfant du premier des Rêves qui transgresse l’interdit en observant, à travers les arbres d’une forêt, le cortège nuptial des hommes-renards [46]. Il en va de même dans Je ne regrette rien de ma jeunesse, au moment où la jeune épouse du « traître » pacifiste, Yagihara Yukie, rejoint ses beaux-parents reclus dans leur ferme et contraints de cultiver leurs champs de riz en pleine nuit pour ne pas s’exposer à l’opprobre des villageois. De même que Dersou se distingue, jusqu’à son déclin, par son regard d’aigle, Yukie va apprendre à exercer l’acuité de son regard dans l’obscurité, pareille à un oiseau de nuit [47]. Parfois ce sont les larmes qui embuent le regard de l’observateur comme pour la chef des ouvrières Watanabe qui, dans Le plus beau, continue à vérifier les lentilles des canons de combat après avoir appris le décès de sa mère.
En milieu urbain et à l’école de la rue, les foules semblent bien exercer sur l’apprenti observateur une stimulation du même type que celle des fourrés touffus en pleine nature. Dans plusieurs films de Kurosawa en effet, les mouvements de foules perturbent l’identification d’un suspect ou la reconnaissance de fugitifs. La foule non seulement, est « la meilleure des cachettes » comme le constate le général Rokutora dans La forteresse cachée, mais elle offre un terrain privilégié pour exercer son sens de l’observation. C’est particulièrement net dans Chien enragé. Les deux détectives finissent par repérer le criminel pendant un match de base-ball au milieu d’une marée humaine de costumes blancs et de chapeaux qui paraissent tous identiques (comme le fera, dans la salle d’attente d’une gare, le jeune apprenti observateur policier Murakami remarquant les taches de boue séchée qui lui permettent d’identifier Yusa, son double négatif et criminel). Rappelons enfin, pour l’anecdote, que Kurosawa relate, dans son autobiographie, une expérience analogue survenue au cours du tournage de Un merveilleux dimanche, à propos du couple des jeunes amoureux perdus dans la foule :
« Numasaki portait un imper trop grand pour elle, et le genre de fichu que l’on peut voir partout : on ne pouvait donc certainement pas dire qu’ils se détachaient de la foule. Ils se fondaient même si bien dans la cohue des autres couples avec le même genre d’accoutrement terne, que plusieurs fois nous perdîmes leur trace, l’opérateur et moi. » [48]
[46] Cet effet de stimulation paradoxal du sens de l’observation aiguisé par des conditions météorologiques catastrophiques semble valoir également pour la façon de filmer de Kurosawa, toujours en attente d’une accalmie comme le personnage du début de Rashômon, et cela en dépit du retard que les intempéries peuvent entraîner (Voir CA, op. cit., p. 214). Ainsi, sur le tournage de films tels que La légende du grand judo, Le château de l’araignée, Ran, il fallait très souvent attendre et profiter d’une éclaircie pour filmer et tirer au mieux partie de ce répit des éléments. Parfois même, les techniciens ni voyaient pas mieux que les acteurs (comme dans la scène de l’arrivée à cheval des deux vassaux du Château de l’araignée).
[47] La comparaison avec la chouette est explicitement faite par la mère du fils honni.
[48] CA, op. cit., p. 243.

Chez Kurosawa, on n'observe véritablement bien que dans la difficulté à voir, dans des conditions météorologiques, des types de lumière ou des environnements nécessitant une véritable ascèse du regard.
Barberousse 「赤ひげ」 (1965年)
Parmi les étapes quasiment incontournables de cet apprentissage en milieu ouvert ou fermé, naturel ou urbain, figure, dans de nombreux films, la délicate distinction des doubles.
« Chassez l’homonymie, elle revient au galop », tel serait le constat qui ressort de l’extraordinaire prolifération des personnages simulacres et des phénomènes de dédoublement dans l’« hantologie » cinématographique de Kurosawa. Mentionnons pour rappel :
-
Le sosie-ombre de Kagemusha.
-
Le double onirique, mort ou vivant (Chien enragé, Kagemusha).
-
Le spectre ou le revenant (réel ou feint) comme dans Rashômon, Le château de l’araignée, Les salauds dorment en paix, ou encore l’armée des soldats zombis sortant du tunnel dans le 4ème des Rêves. On pourrait penser aussi au chat Nora et à sa possible « réincarnation » féline dans Madadayo.
-
Les vrais ou faux jumeaux (Shingen et Nobukado dans Kagemusha).
-
Les frères et sœurs « siamois » que forment plusieurs couples de personnages liés par un destin tragique et constituant l’un pour l’autre une sorte de négatif. Il arrive parfois que cette relation fusionnelle soit figurée symboliquement par une scène d’entrelacement final. Ainsi, la scène des menottes dans Chien enragé qui suggère la proximité existentielle des deux anciens soldats devenus respectivement criminel et policier ou encore l’échange des talismans entre Kayama et Kameda dans L’idiot, qui finissent par mourir de froid enveloppés dans la même couverture. D’autres fois, le dédoublement de l’ombre et de la lumière s’opère au sein d’un même personnage comme dans la scène où l’ombre de Noge projetée sur un mur répond de manière évasive aux questions de Yukie sur son activisme politique (dans Je ne regrette rien de ma jeunesse).
Il faudrait ajouter à cette typologie minimale des doubles et des effets de dédoublement chez Kurosawa, les fréquents emprunts d’identité et les échanges de noms comme dans entre Nishi, qui a lui-même usurpé son nom de famille, et son ami Itakura.
Nul doute que ces homonymies et ces phénomènes de dédoublements à répétition compliquent la tâche des observateurs ou des enquêteurs en même temps qu’ils brouillent les frontières entre le rêve et l’imaginaire, le vrai et le faux, la vie et la mort [49]. Dans Kagemusha, il ne faut pas moins qu’une chute de cheval pour désarçonner et démasquer l’imposteur, là où les espions des clans rivaux, les courtisanes et même le petit-fils du défunt seigneur de la guerre se sont fait mystifier. C’est, de fait, tout le procès de la vérité et de l’identification, tributaires l’un comme l’autre de l’observation, qui s’en trouve retardés (Kagemusha), différé et parfois forclos (Rashômon) dans le « réalisme hallucinatoire » [50] inhérent au cinéma de Kurosawa.
Hormis cet apprentissage qui progresse à coups de satoris visuels, grâce à la médiation d’un tiers (maîtres d’armes, guides, aînés ou pairs [51]), il existe des types d’épreuves suffisamment brutales pour ouvrir définitivement les yeux sur le réel même lorsqu’il faut s’y brûler les yeux. Prenant le contrepied d’une célèbre maxime de La Rochefoucauld [52], on pourrait dire que pour Kurosawa, le soleil et la mort non seulement peuvent mais doivent être regardés en face, à l’œil nu, fût-ce depuis la porte des enfers ; et cela sans prothèse optique ni paravent pour tenir le réel à distance et en amoindrir la charge tragique, comme on met des lunettes noires pour ne pas se blesser les yeux [53] à la fin d’une éclipse. Cette épreuve de l’observation à la limite du visible, en relation avec une lumière insoutenable ou terrifiante (Vivre dans la peur, Le château de l’araignée, Rêves) est littéralement évoquée par l’un des écrivains favoris de Kurosawa, Dostoïevski, dans L’idiot, à travers le récit rapporté par le Prince des derniers instants à l’échafaud d’un condamné à mort, finalement gracié :
« Il voulait sans cesse se représenter aussi rapidement et aussi clairement que possible, ce qui allait se passer (…) Il se rappelait avoir fixé avec une terrible obstination cette coupole et les rayons qu’elle réfléchissait ; il ne pouvait en détacher ses yeux ; ses rayons (… ) Il déclarait que rien ne lui était plus pénible que cette pensée : « Si je pouvais ne pas mourir ! Si la vie m’était rendue ! »» [54]
Enfin, n’oublions pas que cette vision transgressive — qui rappelle le geste sacrilège des flèches lancées dans la direction du soleil par Washizu dans La forteresse cachée — prend chez Kurosawa, à partir de Rashômon, une forme directement cinématographique, celle d’une caméra pointée vers le soleil :
« (…) Je devais prévoir comment utiliser le soleil lui-même. C’était un de mes soucis majeurs, à cause de ma résolution d’utiliser la lumière et les ombres de la forêt comme thème visuel clé pour tout le film. Je trouvai la solution en filmant réellement le soleil, mais au moment ou Rashômon fut réalisé, c’était encore un des tabous de la prise de vue. On pensait même que ses rayons, frappant directement dans notre objectif allaient brûler la pellicule dans la caméra. Mais mon opérateur, Kazuo Miyagawa, défia hardiment cette convention et réalisa de superbes images. » [55]
Nulle assomption de la vérité pourtant dans ce film où, comme dans l’argument du Crétois, la vérité et le mensonge demeurent indiscernables [56], y compris pour le spectateur qui finit par douter de ce qu’il a vu. Aucune voix ne pèse davantage qu’une autre ; aucun témoin de la scène n’est privilégié, pas même le fantôme du défunt. Seul le crime est sûr.
Dans tous les cas, le personnage est tiré de sa rêverie ou de son idéalisme par la vision d’une scène traumatique qui marque le début de sa conversion à l’observation, comme Yukie, la jeune fille de Je ne regrette rien de ma jeunesse, qui découvre au beau milieu d’un paysage bucolique un soldat grièvement blessé rampant dans les herbes.

[49] Sans oublier les particularités inhérentes à l’« hantologie » de l’image cinématographique (Derrida) qui produit déjà par elle-même des personnages-spectres et qui peut favoriser également la formation de « régimes cristallins » au sens du philosophe Gilles Deleuze, c’est à dire de types d’images introduisant une indiscernabilité entre le réel et l’imaginaire, le vrai et le faux (voir L’image temps, Paris, Minuit, 1985, chapitre 6 : « Les puissances du faux »).
[50] Suivant une expression de Michel Estève à propos des difficultés pour le spectateur de distinguer lui-même le rêve de la réalité dans certaines scènes des films de Kurosawa (en particulier dans L’idiot).
[51] L’une des caractéristiques constantes de ces personnages formateurs, qu’il s’agisse de Sanjuro, de Barberousse, de Dersou ou encore du professeur Uchida, dans Madadayo, est qu’ils sont des maîtres malgré eux, y compris quand ils ont des disciples, voire même des anti-maîtres refusant farouchement ce titre, comme Sanjuro vis à vis des apprentis samouraï.
[52] « Le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement » (Maxime 26). C’était déjà une des leçons de la République de Platon (voir l’épisode de Léontios), dont une œuvre comme celle de Dostoïevski pourrait fournir une antithèse sur le plan romanesque.
[53] Dans Rhapsodie en août, les rescapés aveugles de l’école détruite par le feu nucléaire à Nagasaki ont bien vu le soleil et la mort en face, au point d’en avoir les yeux brûlés (comme dans Ran, le jeune prince Tsurumaru qui a eu les yeux crevés par les soldats de Hidetora après l’incendie du château de son père).
[54] Dostoïevski, L'idiot, Livre I, chapitre VI. On se souvient que cet extrait est à l’origine du titre du film Vivre / Ikiru.
[55] CA, op. cit., p. 301.
[56] Le problème de la distinction entre le « vrai » et le « faux », entre le réel et l’apparence est chez Kurosawa, comme dans la philosophie de Nietzsche, étroitement dépendant d’évaluations en termes de vie et de mort, beaucoup plus fondamentales. Ce perspectivisme généralisé fait de la vérité un problème secondaire et dérivé, même lorsque sa recherche semble orienter l’intrigue d’un film (comme dans Rashômon).
« Je devais prévoir comment utiliser le soleil lui-même. »
Kurosawa Akira

Vivre dans la peur
「生きものの記録」
(1955年)
Le cas des enfants et de certains animaux (comme le cheval « aux yeux en amande » de Madadayo) semble contredire l’hypothèse selon laquelle le sens de l’observation dériverait toujours, chez Kurosawa, d’un apprentissage ou d’une vision douloureuse. Ne trouve-t-on pas en effet dans plusieurs films des personnages d’observateurs-nés, tels que les jeunes enfants, et cela indépendamment de tout apprentissage apparent ? Ainsi en va-t-il manifestement pour les deux enfants de Entre le ciel et la terre qui se signalent par leur sens aigu de l’observation, comme l’attestent le dessin que fait Shinichi de son ravisseur, et qui aperçoivent avant les adultes la fumée rose permettant de le localiser ; ou encore l’enfant qui voit, avant son cousin venu d’Amérique, une colonie de fourmis escalader une rose dans Rhapsodie en août. L’enfant pourrait bien dès lors incarner une capacité d’observation brute, vierge de tout apprentissage, en même temps qu’un exemple pour l’adulte empêtré dans ses projets ou ses spéculations métaphysiques dont il lui faut sans cesse dessiller le regard ou feindre d’adhérer aux chimères sans en être dupe, tel le fils du clochard dans Dodes’kaden. C’est probablement le sens à extraire d’une historiette que Kurosawa aimait raconter à ses propres enfants, dans laquelle un marchand d’or donne chaque jour à ses fils une pièce d’or pur à 100% puis d’autres pièces contenant progressivement de moins en moins d’or en pensant, à tort, qu’ils ne s’en apercevront pas.
On retrouve le même sens de l’observation chez ce quasi-enfant qu’est l’idiot dont Dostoïevski insiste, dans son roman éponyme, sur l’acuité visuelle, les talents de conteur, et comme dans l’adaptation de Kurosawa, sur l’extraordinaire capacité à lire toute l’histoire d’un individu sur son visage [57]. Malgré ces exceptions possibles, qui réactivent en partie la figure romantique de l’enfant-voyant, la plupart des personnages adultes de Kurosawa ne deviennent observateurs que contraints et forcés à la suite d’une vision tragique ou au terme d’un apprentissage douloureux. On peut penser ici à la remarque faite par Dersou aux soldats russes — « Vous êtes des enfants, vos yeux ne voient pas » [58] — qui nuance l’idée d’un don d’observation inné chez les enfants, de même que, dans Kagemusha, la scène où Takemaru, le petit-fils de Shingen, démasque le sosie du premier coup d’œil (« Mais ce n’est pas mon grand-père ! ») mais finit par accepter qu’il ait pu beaucoup changer au point de ne plus lui inspirer de peur.
[57] Dostoïevski, L’idiot, livre I chapitre 4. « Tout en étant presque un enfant », comme le professeur au cœur d’or pur de Madadayo réprimandé par son épouse, l’idiot à qui les filles de la générale demandent de leur enseigner l’art de regarder, fait ainsi preuve d’un rare talent pour reproduire des signatures calligraphiées et décrire les paysages qu’il a observés.
[58] Reproche faisant lui-même écho à celui de l’idiot dans Dostoïevski : « Comment peux-tu dire que tu ne sais pas regarder ? Tu as des yeux. Regarde » (Ibid., Livre I, chapitre 5).
Relevons pour terminer que nul n’est besoin d’une prothèse optique (radiographie, appareil photo, fusil a lunettes, outils d’observation du géomètre) pour bien observer, y compris à travers les corps comme Barberousse le médecin humaniste des souffrances physiques et des misères humaines. Bien au contraire, dans les films de Kurosawa (qui se dit lui-même incapable de se servir d’un appareil photo ordinaire [59]), le recours à un instrument peut faire écran à l’observation. Tout au plus l’appareil optique (radio, film ou photo) apporte-t-il parfois une confirmation de ce qui a été observé par l’œil (les photographies dans Chien enragé ou Rhapsodie en août, la radiographie dans Vivre ou L’ange ivre [60]). Pire encore, ces différents types d’appareils peuvent, dans certaines situations, fausser l’observation voire entraîner la mort du personnage, comme le fusil à lunettes offert à Dersou par Arseniev, qui agit tel un véritable « pharmakon » [61] optique. La scène du lac gelé au cours de laquelle Arseniev, absorbé par son appareil de géomètre, ne voit pas l’arrivée du danger anticipe déjà par elle-même sur ce risque mortel dont peut être porteur une prothèse optique quand elle n’est pas adaptée au milieu de vie dans lequel évolue le personnage. Le trépied qui supporte les instruments de mesure du géomètre ne devient en effet utile qu’à partir du moment où il est détourné de sa fonction première pour servir d’armature à une tente de fortune bâtie dans l’urgence à partir d’ajoncs retirés de la glace. La photographie elle-même, quand elle n’est pas pure falsification (comme dans Scandale), suffit rarement à accéder au réel. Mieux vaut pour les personnages observateurs se déplacer et aller voir de leurs propres yeux, s’ils veulent viser juste.
[59] CA, op. cit., p. 79.
[60] On pourrait à la limite trouver une exception dans Vivre avec la radiographie qui révèle le cancer incurable de Watanabe, ou, dans Les salauds dorment en paix, avec la photographie des funérailles de Furuya qui permet à Miyamoto de comprendre la véritable identité de Nishi cherchant à venger la mort de son père. Encore faut-il savoir observer la radio et la photo pour formuler un diagnostic juste (par exemple sur l’expression de chagrin du visage de Nishi). Deux personnes différentes peuvent fort bien regarder la même photographie et ne pas être sensibles de la même manière à l’expression d’un visage (c’est le cas dans L’idiot au moment où Kameda entrevoit dans l’expression du regard de Taeko Nasu, sa « sœur spirituelle », l’expérience d’une grande souffrance). De même, dans Le plus beau, c’est l’œil des ouvrières qui vérifie en dernier recours la conformité des lentilles de canon aérien. Non le microscope.
[61] Le pharmakon est un remède-poison qui fonctionne dans les deux sens, pouvant apporter tantôt la vie, tantôt la mort. Voir l’étude classique de Jacques Derrida au sujet du Phèdre de Platon (« La pharmacie de Platon » (1968) in La dissémination, 1972, Seuil, coll. Points-Essais, p. 79-213).
L’observation comme question de vie et de mort :
le paradigme de Schrödinger au cinéma
Si le cinéma de Kurosawa a tendance à valoriser les personnages observateurs (fussent-ils hallucinés) au détriment des personnages plus contemplatifs, comme les théoriciens, ou les géomètres, c’est avant tout parce que l’observation engage très souvent dans son cinéma des problèmes de vie et de mort.
On pourrait schématiquement distinguer trois situations au moins qui, dans certains films, peuvent en partie se recouper. Tout d’abord les situations dans lesquelles la vie des personnages eux-mêmes est directement engagée par la justesse de leur observation. C’est particulièrement net pour les scènes de combat à mort (par exemple celles des deux Légendes du grand Judo ou le duel final de Sanjuro) mais aussi dans cette autre lutte pour la vie quotidienne à laquelle se livrent Dersou et les soldats russes face aux rigueurs hivernales de la taïga. On peut penser également, dans Barberousse, à l’épingle à cheveu avec laquelle la jeune hystérique cherche à tuer Yasumoto et qu’il fixe avec terreur. Parfois il peut s’agir davantage de la vie sociale ou professionnelle d’un personnage que de sa vie biologique comme, dans Scandale, les réputations du peintre et de la chanteuse à succès compromises par une photographie de paparazzi ou, dans Entre le ciel et l’enfer, la situation sociale de l’industriel qui doit payer une rançon au ravisseur d’enfants : « C’est ma vie que je joue » déclare-t-il aux enquêteurs.
On trouve également des situations dans lesquelles il en va de la vie d’un tiers : le malade observé par le médecin (L’ange ivre, Barberousse, Vivre), l’enfant menacé de mort par son ravisseur dans Entre le ciel et l’enfer, la vie des soldats japonais qui vont utiliser la lentille de canon non vérifiée dans Le plus beau, ou encore la vie de Dersou désireux de revenir dans la taïga malgré sa vue déficiente.
Enfin, un troisième problème de vie et de mort qui implique l’observation est étroitement lié aux problèmes de fantômes, de revenants ou de doubles à propos desquels une même question est posée et parfois explicitement formulée par les personnages : « Est-il mort ? Est-il vivant ? ». Là encore le sens du mot « vie » peut varier en fonction de connotations plus ou moins métaphoriques. Le fonctionnaire Watanabe dans Vivre est ainsi surnommé « la momie » par ses collègues, comme s’il était déjà mort de son vivant alors qu’il va paradoxalement se mettre à revivre intensément après avoir lu dans le regard des médecins sa condamnation à une mort imminente.
Dans les trois cas distingués, les personnages sont souvent soumis à l’urgence [62] d’une observation qui, si elle ne fournit pas une réponse rapide aux situations qu’ils affrontent, peut les exposer à la mort, qu’il s’agisse de leur mort ou de celle d’un tiers : opérations chirurgicales critiques, combats, survie dans un milieu naturel ou humain hostiles, poursuite d’un criminel armé, examen ou recherche d’une arme pouvant être utilisée (comme dans Le plus beau et Chien enragé).

Barberousse 「赤ひげ」 (1965年)
[62] Le philosophe Gilles Deleuze a bien vu que les personnages de Kurosawa, comme ceux de Dostoïevski, étaient habités par l’urgence d’une situation qui les contraint, dans l’action, à « chercher quelle est la question la plus pressante encore » (L’image mouvement, op. cit., p. 257-258). Force est de constater que cette question est souvent, chez les personnages de Kurosawa, une question de vie et de mort dont la solution peut aussi nécessiter des explorations oniriques ou hallucinatoires.

L’observation est étroitement liée aux problèmes de fantômes, de revenants ou de doubles, à propos desquels une même question est posée et parfois explicitement formulée par les personnages :
« Est-il mort ? Est-il vivant ? ».
Le château de l'araignée 「蜘蛛巣城」(1957年)
En ce qui concerne le troisième cas de figure, l’observation clinique et critique du caractère vivant ou non d’un personnage (humain ou non humain), on pourrait parler d’une sorte de paradigme de Schrödinger à l’œuvre dans de nombreux films de Kurosawa. Dans un de ses romans, l’écrivain Philippe Forest, s’inspirant librement du fameux paradoxe éponyme, résume de la façon suivante la suspension de l’opposition mort-vivant présupposée par l’expérience fictive et en un sens impossible du même savant :
« Dans une boîte, on enferme un chat avec à ses côtés un mécanisme plutôt cruel. Celui-ci est constitué d’un dispositif conçu de sorte que l’émission d’une particule, consécutive à la désintégration d’un atome, telle que peut l’enregistrer un compteur Geiger repérant la présence d’une source radioactive, entraîne la chute d’un marteau sur la fiole de verre contenant un poison foudroyant dont l’évaporation dans l’espace où il a été confiné fait instantanément passer l’animal de vie à trépas (…) Sauf que précisément, le propre du phénomène ainsi étudié conduit à compliquer sérieusement la donne de départ (…) Tant que dure l’opération et que l’observation ne la fait pas s’interrompre, il faut supposer en même temps que l’atome est et n’est pas désintégré, que le chat est mort et qu’il est vivant. » [63]
Il se trouve que ce problème de savoir si tel ou tel être est mort et/ou vivant passe souvent chez Kurosawa non seulement par l’observation mais également par l’ouverture de boîtes dans lesquels sont enfermés des personnages : le cercueil de la scène du rêve dans L’ange ivre, reprise sur un registre plus comique dans le transport en lieu sûr de Sanjuro, à demi-mort, dans le tonneau-cercueil de Yojimbo ; le palanquin qui dérobe aux regards le corps mortellement atteint de Shingen et l’urne funéraire où est ensuite placée sa dépouille dans Kagemusha. Tant que l’on a pas ouvert une boîte ou une pièce (comme pour le détective Sato opéré en urgence derrière les cloisons d’une pièce fermée, dans Chien enragé), déplié un paquet (comme dans Ran la tête de la femme-renarde apportée à Dame Kaede), ouvert un paravent (comme celui qui dissimule le corps « endormi » de Nasu Taeko à la fin de L’idiot) et aussi longtemps que l’observation n’a pas tranché, il est rigoureusement impossible de savoir si un personnage est ou non vivant, s’il est bien réel ou s’il est un spectre, à l’instar du fonctionnaire Wada, caché par Nishi dans la journée après son suicide simulé, mais qui se présente la nuit à ses collègues pour les terroriser (Les salauds dorment en paix). De la même manière, dans Barberousse, Sahachi raconte avoir fouillé sans succès les décombres fumantes de sa maison pour retrouver sa femme Onaka après le terrible séisme qui transforme Tokyo en un champ de ruines. Il ne l’y trouve pas mais ignore pendant près de deux années si elle est morte ou vivante, avant de la croiser par hasard dans une rue.
La frontière qui sépare la mort et la vie est en outre brouillée par l’aspect spectral ou cadavérique de certains personnages vivants, comme dans Dodes’kaden qui ressemblent, par leur maquillage facial, aux cadavres cireux ou aux zombis blafards que l’on peut voir, par exemple, dans Kagemusha ou Rêves (en particulier les soldats morts-vivants sortant d’un tunnel). Il se trouve que ces personnages ambivalents habitent souvent dans des sortes de boites métalliques (baraques en taule ou carcasses de voiture) ou sont logés dans de dérisoires sarcophages de carton, comme le fonctionnaire-momie de Vivre, entouré dans son bureau par une muraille de dossiers. Il arrive d’ailleurs fréquemment que les autres personnages qui côtoient ces « hommes-boîtes » — voire le spectateur qui les observe — se demandent à leur propos s’ils sont des hommes ou des spectres, s’ils sont morts ou vivants. Ainsi dans Dodes’kaden, l’homme cloîtré dans son abri de fortune, situé en face d’un arbre mort, passant le plus clair de son temps à déchirer des bandes de tissu ; ou le fils du clochard victime d’une intoxication alimentaire qui agonise en silence dans une 2CV sans roues. Le personnage du revenant peut dans certains films être aussi un animal disparu comme le chat Nora dans Madadayo, dont on ignore s’il est encore vivant et que les anciens étudiants du professeur tentent de retrouver parmi les décombres de la ville bombardée. De la même manière, il faut attendre la sortie du tunnel, dans la quatrième séquence des Rêves, pour savoir si les soldats sont morts ou vivants.
Malgré tout, chez Kurosawa l’observation, fût-elle clinique, ne permet pas toujours de trancher [64]. Le propre des spectres et des images spectrales produites par l’« hantologie » cinématographique n’est-il pas précisément de dépasser l’alternative mort / vivant en même temps que l’antinomie du réel et de l’imaginaire ? Le philosophe Jacques Derrida, relie ainsi « la structure de part en part spectrale de l’image cinématographique » avec le dépassement de l’opposition binaire mort / vivant :
« Le spectre, ni vivant ni mort, est au centre de certains de mes écrits, et c’est en cela que pour moi, un pensée du cinéma serait peut-être possible. » [65]
[63] Philippe Forest, Le chat de Schrödinger, Paris, Gallimard, 2013, p. 17-18.

Dodes'kaden
「どですかでん」(1970年)
[64] Même s'il arrive qu’elle le fasse parfois comme, dans Kagemusha, le vêtement déchiré du sosie suite à sa chute de cheval, qui laisse apparaître aux courtisanes son dos nu dépourvu de cicatrices, révélant du même coup au grand jour son imposture et la mort de Shingen.
[65] Dans son entretien avec Antoine de Baecque et Thierry Jousse pour les Cahiers du cinéma (« Le cinéma et ses fantômes », Cahiers du cinéma, avril 2001, p. 77). Voir également dans le film Ghost dance de Ken Mc Mullen’s, sorti en 1983, l’extrait dans lequel le philosophe, jouant son propre rôle et tentant de répondre à une question de l’actrice Pascale Ogier (« Est-ce que vous croyez aux fantômes ? ») définit le cinéma comme « l’art de faire revenir les fantômes ». On écoutera enfin l’entretien de 2004 entre le metteur en scène de théâtre Daniel Mesguich et le critique de cinéma Charles Tesson dans les suppléments de L’idiot (dans le coffret Akira Kurosawa des éditions MK2, « L’interprète : scènes commentées »). Mesguich, y rappelant l’étymologie latine commune de « spectre » et de « spectacle », affirme à son tour qu’« au cinéma, il n’y a que des spectres ».
« Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça : c'est l'art de laisser revenir les fantômes. »
Jacques Derrida
Chez Kurosawa, la scène la plus emblématique illustrant ce paradigme et cette spectralité indécise se trouve sans nul doute dans la scène du rêve de L’Ange ivre. Cette course à tombeau ouvert, dans laquelle le yakuza est poursuivi par son double, montre bien qu’on n’est finalement jamais complètement mort ni vivant au cinéma, ni identique à soi. Comme dans le rêve, en somme [66]. « Parfois je ne sais plus qui je suis, si je suis mort ou vivant » déclare le fonctionnaire Wada dans Les salauds dorment en paix. Et lorsque, dans Yojimbo, Sanjuro sort à grand peine du tonneau dans lequel il a été transporté, le porteur constate qu’il a l’air « plus mort que vivant ».
Cette indécidabilité et cette indiscernabilité entre la vie et la mort peuvent certes être résolues par l’observation, tant au niveau du personnage que du spectateur, notamment par la progression de l’intrigue. Ainsi Wada est-il finalement reconnu comme vivant dans Les salauds dorment en paix et Shingen comme mort dans Kagemusha. Elle se complique pourtant souvent chez Kurosawa en raison de trois causes principales : en premier lieu, en raison du langage utilisé par les personnages et de l’évaluation non clinique, induite par des termes tels que « mort » et « vivant » qui possèdent des sens multiples, parfois métaphoriques, et qui excèdent dans tous les cas la seule dimension organique du problème. Si le bureaucrate Watanabe est surnommé « la momie » dans Vivre c’est bien parce qu’il est perçu à la fois comme vivant et non vivant par ses collègues. La nature hybride des véritables spectres (Le château de l’araignée), des démons (Rêves) ou des revenants (Rashômon) implique également une certaine indiscernabilité de la vie et de la mort y compris sur le plan des images, encore accentuée par le caractère hallucinatoire des scènes de rêve ou de cauchemar (L’Ange ivre, L’idiot, Kagemusha), la prolifération des doubles (Kagemusha, Les salauds dorment en paix et, dans une moindre mesure, Chien enragé), ou encore les usurpations d’identité. Est-ce bien Nishi que l’on retrouve mort dans sa voiture, suite à un meurtre maquillé en accident ferroviaire, ou Itakura sachant que les deux amis avaient au préalable échangé leurs papiers d’identité (Les salauds dorment en paix) ? Pour l’opinion publique et dans la version officielle, c’est bien Nishi qui est mort. Et pourtant le « vrai » Nishi est toujours vivant, à l’instar de Wada assistant à ses propres funérailles et jouant au fantôme pour effrayer son collègue Shinrai, ou du jeune yakuza de L’ange ivre, poursuivi dans son rêve par son double surgi d’un cercueil, comme un diable hors de sa boîte. Soulignons enfin, dans les propos des personnages, le recours fréquent à des métaphores ou à des hyperboles qui introduisent du jeu dans le partage « mort » / « vivant » comme dans Entre le ciel et l’enfer au moment où l’industriel dit « jouer sa vie » avant la remise de la rançon (confondant du même coup la mort clinique avec la mort sociale).
L’observation est donc, dans le cinéma de Kurosawa, autant une question de vie et de mort qu’une question de vie ou de mort. Elle joue certes un rôle essentiel pour séparer l’une de l’autre, jusque dans les images elles-mêmes, mais elle bute souvent sur des figures spectrales ou des êtres mixtes qu’il faut paradoxalement accepter de considérer, à l’instar du chat de Schrödinger dans sa boîte, comme morts et vivants à la fois.
[66] Sur le plan de la biographie, on peut rapprocher cette situation filmique d’un épisode relatif à la mort du frère, que Kurosawa présente comme une « histoire dont il ne voulait pas parler » : « Quand nous eûmes mis le cadavre de mon frère que nous avions fait venir à Tokyo, le corps se mit à émettre un profond gémissement. Ce devaient être ses jambes, repliées contre sa poitrine, qui faisaient sortir l’air par sa bouche. Le chauffeur se mit à trembler mais il parvint à ramener le corps au crématorium, où il serait incinéré. » (CA, op. cit., p. 147).

Si la vue m'était rendue :
pour une morale cinématographique de l'observation
En tentant de mettre en évidence l’importance et les enjeux du motif de l’observation dans le cinéma de Kurosawa, nous n’avons pas cherché à reconstituer une philosophie implicite pouvant rendre compte des principales originalités de ses films. Il s’agissait bien plutôt de nous mettre à notre tour dans une position d’observateur pour relever un certain nombre de récurrences dans la façon dont Kurosawa fait intervenir le problème de l’observation, à travers des situations variées, et de réfléchir sur les conséquences de ce souci d’observer sur le plan du personnage, du montage cinématographique et du spectateur.
À défaut de philosophie, on pourrait en revanche trouver chez Kurosawa une morale [67] cinématographique de l’observation dans l’exigence d’ouvrir les yeux sur les réalités les plus insoutenables, qui entre en résonnance avec certains épisodes traumatiques de sa propre biographie, en particulier l’excursion dans les décombres du grand tremblement de terre de Tokyo et l’histoire quasiment irracontable de la mort du frère aîné. De ces deux scènes initiatiques, inséparablement biographiques et cinématographiques découle la conviction, partagée avec Dostoïevski, que seul un regard qui endure le spectacle de l’impossible peut vaincre la peur [68] et retrouver le sens du réel. C’est en effet à ce prix que l’attention pour tout ce qui vit, y compris les plus petites vies auxquelles le regard de l’enfant est sensible, peut faire retour dans l’existence et atteindre son acmé. Ce moment de la grande humilité du regard [69] et de la grande compassion pour les vies les plus modestes, se retrouve aussi bien chez des personnages comme l’idiot ou Dersou Ouzala (soucieux, l’hiver venu, de laisser quelques miettes aux oiseaux ou au rongeurs de passage dans une cabane de bucherons) que chez Watanabe dans Vivre ou dans la tristesse qui étreint le vieux professeur de Madadayo après la disparition de son chat. Il fait également écho aux récits d’expérience de tous ceux qui ont vu la mort en face et qui, au sortir de cette épreuve qui a décidé de toute l’orientation de leur vie, décrivent souvent la manière dont leur regard a été aimanté, au sortir de l’enfer, par la palpitation d’une vie modeste au point d’avoir passé un long moment à la fixer. C’est à cette expérience très particulière d’observation de celui qui « revient » de la mort ou qui survit à une existence dévastée que fait référence Maurice Blanchot dans L’instant de ma mort, évoquant dans le droit fil de L’idiot de Dostoïevski, le retour au réel d’un jeune homme dont l’exécution imminente a été suspendue :
« Je crois qu’il s’éloigna toujours dans le sentiment de légèreté, au point qu’il se retrouva dans un bois éloigné, nommé « Bois des bruyères », où il demeura abrité par des arbres qu’il connaissait bien. C’est dans le bois épais que tout à coup il retrouva le sens du réel. » [70]
De la même manière, au terme de l’« horrifiante excursion » imposée par le frère aîné dans les ruines jonchées de cadavres putréfiés, Kurosawa évoque un moment d’observation en tous points analogue que l’on peut retrouver dans plusieurs de ses films, en particulier chez les enfants (dans Entre le ciel et l’enfer et Rhapsodie en août notamment) : celui d’un regard fixant une tache de couleur qui se détache d’un fond monochrome (telle une fleur qui repousse sur une terre calcinée) par où se signale la palpitation d’une petite vie :
« Mais à ce moment là, je demeurais immobile, gardant les yeux fixés sur un coin de verdure en haut des collines de Ueno. Cela faisait combien d’années que je n’avais pas vu un arbre vert ? Je me sentais comme quelqu’un qui a fini par trouver de l’air, au bout d’une longue recherche. Parmi toutes ces ruines laissées par l’incendie, il n’y avait jamais eu même une petite tache de vert. Je n’avais jamais pensé jusqu’alors que la végétation pût être quelque chose d’aussi précieux. » [71]
Nul doute que cette petite vie qui restitue le réel à sa couleur doive faire elle aussi l’objet d’une observation minutieuse, a fortiori lorsque le peintre ou le dessinateur se font cinéaste.

[67] C’est le terme qu’utilise Serge Daney à propos de l’excursion initiée par le frère disparu, juste après le grand séisme de 1923 et du macabre spectacle vu « par les yeux d’un enfant stoïque qui obéit à son grand frère » : « Du grand tremblement de terre du Kanto qui détruisit Tokyo, Kurosawa retient deux choses : une vision d’enfer (« imprimée à tout jamais derrière mes paupières ») et une morale d’acier (il faut regarder, il faut « bien » regarder). » Ciné journal, vol.II, op. cit., p. 218-219.
[68] Suivant l’explication donnée par ce même frère au sujet de l’absence de cauchemars qui surprend son cadet à la suite de l’excursion imposée : « Si tu fermes les yeux devant un spectacle effrayant, la terreur va finir par te gagner. Si tu le regardes en face, il n’y a plus rien qui puisse te faire peur. » (CA, op. cit., p. 99). Kurosawa retrouve bien la même analyse de la part de Mori Masayuki au sujet de sa peur du sang et des moyens de la surmonter : « Je hais le sang. Quand nous avons fait L’idiot, Mori Masayuki m’a dit : tu es une poule mouillée. À la première vue du sang, il est évident que tu recules. C’est vrai. Je lui ai demandé pourquoi : « Parce que tu y penses trop. » J’ai peur parce que j’y pense trop ? Ou le contraire ? Qui sait ? ».
[69] « La force la plus terrible qui soit est celle de l’humilité » déclare l’idiot de Dostoïevski.
[70] Maurice Blanchot, L’instant de ma mort, Paris, Gallimard, 2002, p. 12. Sur les relations possibles entre la vision chez Kurosawa et le problème du voir comme contact saisissant du réel chez Blanchot, lire la note 1 p. 42 de l’étude d'Alain Bonfand.
[71] CA, op. cit., p. 99.
Hervé COUCHOT
©2016 by Hervé Couchot/Tokyo Time Table
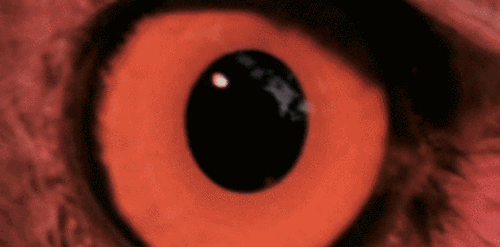
Vivre 「生きる」(1952年)
